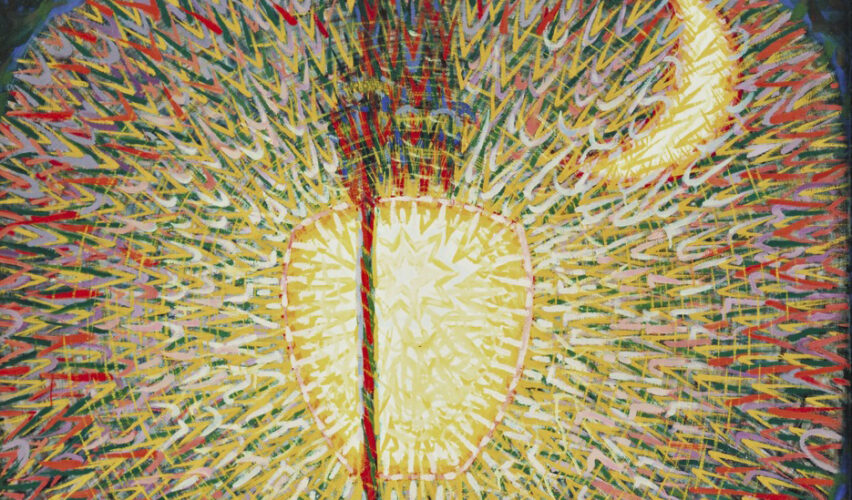Depuis sa création, l’Union européenne a fait du secteur énergétique un levier central d’intégration, cherchant à consolider un marché unique et à renforcer les solidarités entre États membres. Confrontée au changement climatique, cette « Union de l’énergie » mise notamment sur l’électrification, le développement massif des interconnexions transfrontalières et sur un marché de l’électricité intégré. La France, de par les caractéristiques de son mix et de son réseau, admet une position singulière au sein de ce système électrique européen. Dès lors, des tensions peuvent surgir avec les orientations européennes, tant sur les questions de financement des réseaux que sur le rôle des interconnexions ou bien sur le fonctionnement du marché de l’électricité. Intégrer davantage les spécificités nationales dans la gouvernance de l’Union de l’énergie sera crucial pour mener à bien la transition énergétique européenne.
Introduction
En 2015, la Commission Juncker lance l’initiative « Union de l’Energie ». Parmi ses principaux objectifs figure celui d’assurer la sécurité d’approvisionnement grâce à la solidarité et la coopération entre États membres. En matière d’électricité, domaine central pour atteindre les ambitieux objectifs climatiques de l’Union européenne (UE), cette exigence de solidarité se concrétise notamment par un dispositif visant à développer rapidement de nouvelles interconnexions transfrontalières.
Il faut dire que les réseaux électriques, et leur capacité à accompagner la transformation rapide de la production d’électricité, sont au cœur de nombreuses inquiétudes. Infrastructures vieillissantes et associées à des délais de construction très importants, elles pourraient devenir le « goulot d’étranglement » de la transition énergétique, en Europe et dans le monde. Les institutions européennes entendent éviter cet écueil en promouvant un réseau fortement interconnecté. Autrement dit, en poursuivant une dynamique de changement d’échelle : l’approvisionnement en électricité est, de plus en plus, une question qui dépasse les frontières des Etats membres, au risque de susciter des conflits entre cadre national et cadre européen.
Dans cette note, nous étudions ces tensions dans le cas français. En mettant en évidence les spécificités de la France en matière d’électricité, nous cherchons à expliquer en quoi ce « conflit des mailles » entre Etat et UE s’y joue d’une façon particulière. Sur le plan de la production, la France s’appuie massivement sur le nucléaire, au contraire d’une Union européenne qui, dans ses objectifs de décarbonation, met l’accent sur les énergies renouvelables intermittentes. Sur le plan du réseau électrique, elle est un « carrefour électrique » robuste, prudent face à la perspective de nouvelles interconnexions avec des réseaux plus congestionnés. Si elle devra faire face à des investissements importants dans son réseau, ces-derniers se situent plutôt dans la fourchette basse de l’UE. Enfin, la France entretient un rapport particulier avec le marché commun de l’électricité : les directives européennes en la matière ont été mises en place avec moins d’entrain qu’ailleurs et font face à de fortes contestations.
Ces spécificités déterminent largement les priorités françaises en matière d’Union de l’énergie. Elles expliquent notamment que les dysfonctionnements du marché constituent un point de friction particulièrement important, revenu au cœur du débat public après la crise de 2022. Pour embarquer la France dans une transition énergétique qui change d’échelle, la prise en compte de cette position française singulière sera indispensable.
Un modèle électrique particulier face à la transition européenne
1. La singularité du mix électrique français
Production totale d’électricité en France en 2024 (TWh) et répartition par filière
La production d’électricité française est parmi les plus décarbonées au monde. Près de 95 % du mix est issu de sources bas-carbone, un record historique, tandis que la part des énergies fossiles est tombée à son plus bas niveau depuis 1952. Les données du bilan annuel du gestionnaire du réseau de transmission français (RTE) soulignent le rôle central joué par la complémentarité entre le parc nucléaire, pilier structurel du système électrique français, et les énergies renouvelables (EnR), au premier rang desquelles l’hydraulique, mais aussi l’éolien et le photovoltaïque.
Les tendances récentes confirment cette dynamique. Après la crise énergétique de 2022, la production nucléaire a nettement rebondi. Le mix français a ainsi retrouvé sa structure traditionnelle : environ deux tiers de nucléaire, un tiers de renouvelables, et une fraction résiduelle de thermique fossile. Cet équilibre, relativement unique en Europe permet à la France de disposer d’une électricité peu carbonée et largement pilotable. Cette configuration se traduit également par une position structurellement exportatrice : la France figure régulièrement parmi les premiers exportateurs nets d’électricité du continent, profitant de ses excédents nucléaires et hydrauliques pour alimenter ses voisins européens.
Ce paysage énergétique s’inscrit dans une trajectoire historique commencée au milieu des années 1970. À la suite du premier choc pétrolier, le gouvernement engage un basculement décisif en lançant le plan Messmer (1974), vaste programme de construction de réacteurs destiné à assurer l’indépendance énergétique du pays face à la volatilité des prix des combustibles fossiles. Ce choix stratégique repose alors sur un double socle : la volonté politique de garantir la souveraineté énergétique et l’existence d’un avantage comparatif en capital humain, fondé sur la solidité du tissu scientifique (CEA, grandes écoles d’ingénieurs) et industriel (Framatome, EDF) capable de concevoir, construire et exploiter un parc standardisé à grande échelle. Cette décision a profondément structuré l’architecture institutionnelle, industrielle et technologique du système électrique français, jusqu’à aujourd’hui.
Si le mix actuel est remarquablement bas-carbone, des questions profondes se posent sur son avenir : la modernisation et la maintenance d’un parc nucléaire vieillissant dans un contexte de perte de savoir-faire, l’accélération du déploiement des renouvelables et la transformation des réseaux exigent des investissements massifs et une gouvernance active. Ces tensions techniques, économiques et politiques structurent le débat sur la trajectoire énergétique française.
2. La transition énergétique « à la française » structurée autour d’une opposition EnR-nucléaire, et entourée d’incertitudes
L’engagement français et européen à atteindre la neutralité carbone en 2050 confère une importance déterminante à l’électrification de notre système énergétique et à la décarbonation complète du mix électrique. La Stratégie nationale bas carbone (SNBC), qui fixe la feuille de route générale, identifie d’ailleurs comme priorité la nécessité de « décarboner complètement l’énergie utilisée à l’horizon 2050 ». Elle met en avant la diversification du mix et l’essor des énergies renouvelables, tout en reconnaissant la contribution essentielle du nucléaire. Toutefois, la SNBC ne fournit pas de trajectoire détaillée : elle se limite à dessiner des grandes dynamiques.
C’est précisément le rôle de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de traduire ces orientations en décisions publiques concrètes, en fixant des volumes, des rythmes de déploiement et des jalons temporels. Pour éclairer ces choix, les scénarios prospectifs de RTE présentés dans Futurs énergétiques 2050 montrent qu’une pluralité de trajectoires est techniquement envisageable : davantage de nucléaire ou d’EnR, sobriété plus ou moins forte, hybridations diverses… Ce constat souligne que l’arbitrage ne peut être strictement technico-économique : il engage aussi des préférences sociales, des contraintes financières et des choix politiques.
Dans ce cadre, le calendrier constitue une contrainte majeure. Parce que les projets nucléaires reposent sur des horizons d’investissement très longs, les feuilles de route énergétiques accordent une place accrue au développement des énergies renouvelables intermittentes, seules capables de contribuer significativement aux objectifs de court et moyen terme à l’horizon 2050. Comme le souligne l’Agence internationale de l’énergie, quel que soit le futur du parc électronucléaire, la trajectoire française devra de toute manière reposer sur un déploiement massif des EnR pour respecter ses engagements climatiques.
Pour comprendre une transition énergétique française longtemps structurée autour d’une opposition entre énergies renouvelables et nucléaire, il est indispensable de saisir l’instabilité qui entoure la place de l’atome depuis une quinzaine d’années dans les orientations politiques et juridiques. À partir des années 2010, notamment après l’accident de Fukushima, le débat national s’intensifie : la diversification du mix devient un objectif explicitement assumé, attisé par la crainte d’une dépendance excessive à une seule technologie. Cette orientation se matérialise dans la deuxième PPE, publiée en 2016, dont l’article 12 fixe l’objectif de ramener la part du nucléaire à 50 % de la production électrique à l’horizon 2025. Cette trajectoire est toutefois profondément révisée au tournant des années 2020. En 2022, avec le discours de Belfort, le Président de la République annonce la relance d’un programme d’EPR et la prolongation du parc existant. En 2023, l’Assemblée nationale et le Sénat actent ce changement de cap en supprimant le plafonnement à 50 % et en soutenant explicitement une relance du parc, entérinant ainsi un consensus relatif renouvelé autour de l’atome.
La trajectoire énergétique de la France demeure un sujet de fortes tensions, comme l’illustre la récente « loi Gremillet », marquée par une succession de revirements politiques et institutionnels. Dans ce contexte, il apparaît indispensable de clarifier la position française en matière de planification énergétique, tant celle-ci relève moins d’un consensus technique que d’un choix profondément politique. La très attendue PPE 3 constitue à cet égard un moment décisif : elle doit permettre de stabiliser le cadre stratégique, d’offrir une visibilité accrue aux acteurs du secteur et, ce faisant, de placer la France sur une trajectoire de transition enfin lisible et cohérente.
3. La trajectoire de transition énergétique française dans le contexte européen
Mix électrique par pays, 2023 (en % de la production totale)
La France évolue dans un paysage énergétique européen marqué par une forte hétérogénéité des mix nationaux et des trajectoires de transition. Sa situation semble relativement unique au sein de l’Union européenne, en raison de la place structurante du nucléaire dans son système électrique.
L’examen des trajectoires européennes montre une grande diversité de situations nationales, même si l’ensemble des États membres s’appuie désormais sur des fondamentaux communs : électrification progressive des usages et renforcement de l’efficacité énergétique. En Allemagne, la transition a été engagée dans un contexte de forte dépendance au charbon, combinée à l’abandon de l’atome, ce qui conduit aujourd’hui à un déploiement extrêmement ambitieux des énergies renouvelables : le pays vise notamment 215 GW de solaire d’ici 2030 et poursuit l’essor de l’éolien afin de compenser la fermeture des centrales à charbon. Dans le sud de l’Europe, l’Espagne et l’Italie, dont les mix reposent encore largement sur le gaz naturel et où le nucléaire admet une place plus modeste, misent également sur un développement rapide du solaire (près de 6 GW d’installations par an) et sur le déploiement massif de solutions de stockage, comme les 23 GW de batteries prévus en Italie pour gérer les contraintes de réseau. Les pays scandinaves suivent encore une dynamique différente, portée par un potentiel hydroélectrique et éolien abondant qui les place parmi les systèmes électriques les plus avancés en matière de décarbonation. Enfin, des États comme la Belgique doivent arbitrer entre des contraintes spécifiques : face à une hausse prévue d’environ 70 % de la consommation électrique d’ici 2035 et à un potentiel terrestre limité, le pays s’appuie sur l’éolien en mer et a prolongé la durée de vie de deux réacteurs nucléaires afin de sécuriser son approvisionnement. Dans ce paysage contrasté, la trajectoire française apparaît singulière : comme le montre la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), la part d’énergies renouvelables déjà atteinte par des pays comme l’Allemagne correspond aux niveaux que la France n’envisage d’atteindre qu’à l’horizon 2040, illustrant la diversité des rythmes, des logiques de transformation et des enjeux propres à chaque État membre.
Ces trajectoires nationales très variées expliquent que les transformations engagées chez les voisins européens soient souvent plus profondes que celles observées en France. Partant d’un mix plus carboné et moins nucléarisé, ces États doivent développer les renouvelables à une échelle bien plus importante pour atteindre leurs objectifs climatiques. La France présente ainsi un « retard relatif » en matière de capacités renouvelables installées, mais elle bénéficie en contrepartie d’une avance significative en matière de décarbonation du secteur électrique. Cette situation particulière influence la manière dont la transition est perçue, organisée et planifiée au niveau national.
Capacité d’EnR intermittentes installées et prévues (GW)
Cette singularité française est d’autant plus marquante que le cadre réglementaire européen s’articule principalement autour de cibles visant les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et l’électrification des usages. Le Green Deal européen (2019) fixe un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, complété par le paquet Fit for 55, qui prévoit une réduction d’au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. La directive sur les énergies renouvelables, révisée en 2023, impose un objectif légalement contraignant d’au moins 42 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie en 2030. Or, le nucléaire n’est pas reconnu comme énergie renouvelable dans ce cadre, même s’il reste pleinement autorisé comme technologie de décarbonation. Il ne contribue donc en aucune manière aux objectifs EnR européens, ce qui constitue une difficulté majeure pour un pays comme la France. Cette absence de reconnaissance du nucléaire dans la comptabilité européenne contribue à créer un décalage entre les objectifs européens, très orientés vers le développement des renouvelables et la trajectoire française. Cela pose des questions spécifiques en matière de financement, de gouvernance et de mise en conformité avec les directives européennes, notamment lorsqu’il s’agit de planifier la part relative des EnR dans un système déjà largement décarboné.
Ainsi, malgré un cadre européen commun et une volonté d’intégration accrue des marchés électriques, la transition énergétique demeure en grande partie pilotée à l’échelle nationale. Les spécificités géographiques, climatiques, économiques et politiques de chaque État membre orientent fortement les choix technologiques et les rythmes de transition. La France, du fait de la structure de son mix, suit une trajectoire singulière, tout en devant se conformer aux objectifs européens en matière de développement des énergies renouvelables et d’intégration des marchés.
Le réseau électrique français et européen : interconnexions, congestions et défis d’investissement
1. Interconnexions et objectifs européensL’énergie est au cœur du projet d’intégration européenne. Le traité de Lisbonne n’a consacré qu’en 2009 la compétence de l’Union européenne en matière énergétique, mais la notion de « solidarité énergétique » était déjà au cœur du traité de 1951 instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Dans le domaine de l’électricité, la Conseil européen a institué dès 2002 un objectif d’interconnexion de 10% de la puissance installée pour les Etats membres. Il s’agit alors avant tout d’avancer vers le « marché unique de l’énergie » et de garantir la sécurité d’approvisionnement (Lamoureux, 2021).
L’interconnexion des réseaux électriques européens implique une interdépendance : une défaillance chez l’un des membres du réseau synchrones peut avoir des conséquences au-delà de ses frontières. La panne géante du 4 novembre 2006, qui a touché 15 millions d’usagers à travers l’Europe, a mis en évidence qu’en matière d’électricité, les destins des Etats membres sont liés. Ou, pour employer les mots du Parlement européen, dans un règlement de juin 2019 : « dans un contexte de marchés de l’électricité et de systèmes électriques interconnectés, la prévention des crises électriques et leur gestion ne peuvent être considérées comme étant des missions purement nationales ».
L’idée d’un système électrique européen fortement interconnecté trouve de nouvelles justifications avec la pénétration croissante d’énergies renouvelables intermittentes (solaire, éolien) dans le réseau électrique. En effet, en cas de forte production renouvelable dans une période de faible demande, il est par exemple nettement moins coûteux d’exporter le surplus d’électricité plutôt que de moduler des centrales pilotables (nucléaire ou thermique) à la baisse. Les interconnexions deviennent une source de « flexibilité », tout comme les moyens de stockage ou les dispositifs permettant d’agir sur la demande.
L’implication croissante de l’UE sur le sujet des interconnexions s’explique ainsi par leur contribution simultanée à l’intégration économique de l’Europe, à sa sécurité d’approvisionnement et à la décarbonation de son énergie. En 2015, la Commission Européenne lance l’initiative « Union de l’Energie » et le « Mécanisme pour l’interconnexion en Europe » (MIE). Ce dernier permet notamment d’accélérer des « projets d’intérêt commun », en mettant fortement l’accent sur les interconnexions électriques transfrontalières, grâce à des subventions et des procédures accélérées En 2018, le règlement sur la gouvernance de l’Union de l’énergie introduit un objectif plus ambitieux d’interconnexion : 15% de la capacité de production installée à l’horizon 2030. En 2019, un nouveau règlement a imposé aux Etats membres de s’assurer qu’au moins 70% de leurs capacités d’interconnexion sont disponibles pour des échanges transfrontaliers.
2. La France, un « carrefour électrique » européen
Dans ce projet de système électrique européen interconnecté, la France joue un rôle singulier. En raison de sa situation géographique, elle est un « carrefour électrique ». En 2025, 37 interconnexions électriques transfrontalières lui permettent d’échanger de l’électricité avec 6 de ses voisins européens : Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie et Espagne. Ces interconnexions ont joué un rôle crucial pour engager la transition hors de l’électricité fossile à moindre coût et assurer la sécurité d’approvisionnement, comme le souligne RTE.
Dans le sillage de la dynamique européenne, la France ambitionne de renforcer certaines de ces interconnexions et d’en construire de nouvelles. Entre 2020 et 2030, elle devrait avoir augmenté ses capacités d’import et d’export de près de 40% (+ 9 GW et + 11 GW), grâce notamment à de nouvelles lignes sous-marines la reliant aux réseaux électriques irlandais et espagnol, d’après le Schéma décennal de développement du réseau (SDDR) publié en 2025 par RTE.
Evolution des capacités d’interconnexion à l’import de la France avec ses voisins
Néanmoins, le sujet des interconnexions révèle des tensions entre une transition énergétique pilotée à l’échelle européenne et les prérogatives nationales. Plusieurs Etats membres, parmi les plus gros réseaux électriques de l’Union, sont loin de l’objectif de 15% sur l’interconnexion électrique fixé pour 2030 (Climate Action Nework, 2025) ; en tout cas selon les chiffres des institutions européennes. Car le chiffrage est aussi un point de discorde : alors que les institutions européennes évaluent la capacité d’interconnexion française à 4.7% de sa capacité de production, la CRE met en avant un chiffre de 12,5%, voire 16% selon la méthode de calcul.
Si le SDDR mentionne certains projets d’interconnexions qui iraient au-delà de sa stratégie de référence et chiffre les investissements associés, il met en garde sur les renforcements du réseau interne qui seraient rendus nécessaires par ces nouvelles capacités d’échanges. Peu importe la capacité d’interconnexion lorsque le réseau voisin est trop congestionné pour accueillir un surplus d’électricité. Par ailleurs, la situation française de « carrefour électrique » européen en fait un pays de transit. Certains échanges électriques entre pays passent par le réseau français, ce qui se traduit par des importations à une frontière, et par des exportations simultanées à une autre. Ces « flux de transit » ne permettent pas l’alimentation de consommateurs sur le territoire français, mais impliquent de dimensionner le réseau en conséquence pour éviter les congestions. Dans un rapport publié en 2020, la CRE met en avant l’enjeu de partage des coûts que font naître les interconnexions. Il s’agit de ne pas « pénaliser le réseau français » en lui faisant « porter une partie du renforcement jusqu’ici insuffisant de réseaux voisins ».
RTE, tout comme la Commission européenne, promeut une vision du système électrique à l’échelle européenne. Cependant, alors que les institutions européennes et de nombreux pays voisins veulent avant tout accélérer sur les interconnexions transfrontalières, le gestionnaire du réseau français met en avant l’impact de ces interconnexions sur les réseaux internes, et souhaite soumettre chaque projet à une analyse socio-économique rigoureuse. Dans certains cas, un renforcement du réseau interne dans un pays membre peut être tout aussi efficace du point de vue du réseau qu’une nouvelle interconnexion.
3. Perspectives pour le réseau électrique européen
La question est d’autant plus brûlante que les besoins d’investissements dans le réseau électrique européen sont importants. La Commission a estimé à 584 Mds € les investissements nécessaires dans les réseaux de l’UE d’ici 2030. La France table sur un triplement des investissements annuels dans le réseau de transmission sur la période 2030-2040 (entre 7 et 9 Mds € par an) par rapport à 2024 (2,4 Mds €). En y ajoutant les investissements dans le réseau de basse et moyenne tension, géré par Enedis, on aboutit à environ 200 Mds € cumulés à investir dans le réseau électrique français d’ici 2040.
La plupart des pays européens font face à une situation similaire, mais à des degrés divers. En effet, les coûts de renforcement du réseau sont fortement liés au raccordement des centrales EnR, notamment l’éolien offshore. Dans la stratégie de référence du SDDR, RTE estime que le raccordement des éoliennes en mer à lui seul représentera en 2030 la moitié des investissements annuels dans le réseau de transmission. Dans des pays se reposant plus massivement que la France sur les énergies renouvelables pour décarboner leur mix, ces coûts de raccordement seront nettement plus élevés. Par ailleurs, la France dispose d’un réseau robuste, caractérisé par des taux de congestion faibles. Des réseaux d’ores et déjà congestionnés devront se renforcer d’autant plus pour permettre la transformation du mix.
Une étude commandée par RTE a ainsi comparé les plans d’investissements des principaux gestionnaires de réseau de transmission européens. Le constat est clair : rapporté à la taille de son système électrique, les investissements dans le réseau électrique seront nettement moins lourds en France qu’en Allemagne, au Pays-Bas ou au même au Royaume-Uni.
Investissements annuels moyens prévus dans le réseau de transmission, rapportés à la demande de pointe en 2022 (en millions € par GW et par an)
Cette étude ne porte que sur le réseau haute-tension. Mais le même genre de tendance se dessine dans le réseau de distribution. Selon une étude d’Eurelectric, l’Allemagne devra investir trois fois plus que son voisin français dans le réseau basse et moyenne tension.
4. Un risque de goulot d’étranglement
Les investissements importants à consentir pour adapter le réseau électrique européen font craindre le risque d’un « goulot d’étranglement » : un sous-financement de ces investissements pourrait freiner le développement des EnR et faire dérailler la transition énergétique européenne. D’ores et déjà, dans plusieurs pays européens comme les Pays-Bas, de très nombreuses capacités renouvelables ne sont pas raccordées faute d’un réseau suffisamment développé pour accueillir leur production. La Commission a annoncé la publication d’un European Grids Package d’ici la fin 2025, pour accélérer la mise à niveau et l’extension des réseaux. En lien avec l’appel à consultation lancé en amont de cette publication, de nombreuses études ont mis en avant des propositions de modes de financement innovant pour les réseaux électriques. Face à l’européanisation du fonctionnement du réseau électrique et à l’importance croissante des flux de transit, ces propositions incluent notamment l’implication plus grande de fonds communautaires. (Rapport interministériel néerlandais, 2025 ; Bruegel, 2025).
Aucune mention de tels sujets dans le SDDR de RTE : sauf à aller plus loin sur les interconnexions que ce que prévoir le gestionnaire de réseau dans sa stratégie de référence, le gestionnaire de réseau français semble serein sur sa capacité à financer le réseau électrique du futur, et insiste sur les « bonnes conditions d’emprunt » dont il bénéficie.
Au sujet des financements européens, le « carrefour électrique » français se retrouve dans une situation particulière. Engagée de fait dans un réseau électrique qui fonctionne à échelle européenne et bénéficiant des nombreux avantages de l’interconnexion, la France a, d’un côté, intérêt a des renforcements des réseaux frontaliers : ce sont bien souvent les insuffisances de ces réseaux qui limitent les échanges transfrontaliers. De l’autre, la question de la légitimité de la mobilisation de fonds européens se pose : s’agirait-il de payer pour compenser une tendance au sous-investissement dans les pays voisins ?
Le marché de l’électricité : vecteur d’intégration européenne mais source de tensions nationales.
Le sujet du financement des investissements dans le réseau est emblématique d’une tension entre l’échelle européenne et l’échelle nationale pour la gouvernance du réseau électrique. Mais en France, c’est autour du fonctionnement du marché commun de l’électricité que la friction entre le cadre national et le cadre européen est la plus sensible. Là encore, le cas français présente quelques spécificités importantes.
1. Genèse du marché de l’électricité européenEn 1986, l’Acte unique européen fait de la création d’un marché unique l’un des horizons de la construction européenne. La politique énergétique européenne a d’abord été pensée comme un moyen d’avancer vers ce marché unique, les enjeux de sécurité d’approvisionnement et de durabilité intervenant dans un second temps (Palle, 2019).
Dans le domaine de l’électricité, cela se traduit en 1996 par une directive du Parlement européen qui définit des modalités d’organisation du secteur de l’électricité dans les Etats membres. Il s’agit d’ouvrir le secteur à la concurrence, vue comme une condition à « l’achèvement du marché intérieur de l’énergie ». Cela suppose, en amont, de mettre en concurrence les producteurs d’électricité qui vendent leur production à des fournisseurs sur des « marchés de gros ». En aval, il faut faire jouer la concurrence entre fournisseurs qui vendent l’énergie au consommateur final sur des « marchés de détail ».
Cette directive de 1996 est progressivement transposée en droit français. Côté production, le monopole public EDF est scindé en trois entités, chargées respectivement de la production (EDF), du transport (RTE) et de la distribution d’électricité (ERDF, puis Enedis). En parallèle, les activités de production d’électricité sont ouvertes à la concurrence. Côte consommation, les consommateurs sont autorisés à choisir des fournisseurs alternatifs à EDF. L’autorisation concerne d’abord les clients commerciaux, avant d’être ouverte en 2007 à l’ensemble des consommateurs, y compris résidentiels. Plutôt que d’opter pour les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRVE), le consommateur peut se fournir sur le marché de détail, à des prix fixés librement par les fournisseurs alternatifs.
2. Bénéfices théoriques et dysfonctionnements réelsLe marché européen de l’électricité présente, du moins sur le plan théorique, de très nombreux avantages, mis en avant par les institutions européennes.
Il permet, dans la limite des capacités d’interconnexions des pays membres, d’optimiser la production électrique à l’échelle du continent. Les centrales les moins chères sont appelées en premier, ce qui permet de réduire les coûts totaux du système par rapport à une optimisation à la maille nationale. Alors qu’un planificateur européen qui piloterait le réseau électrique comme le faisaient les monopoles nationaux serait difficilement acceptable politiquement, le marché remplit la même fonction. Cependant, ce pilotage se fait via un signal prix, c’est-à-dire en théorie de façon transparente et décentralisée. Le marché commun de l’électricité participe ainsi à faire passer la gouvernance du système énergétique européen à la maille de l’UE (Palle, 2017).
En permettant la mise en concurrence des moyens de production, le marché doit aussi inciter à l’innovation, et ainsi pousser les prix à la baisse et améliorer la compétitivité européenne. Il se voit confier de nouvelles missions dans le contexte de la transition écologique : combiné à un prix du carbone qui renchérit les moyens de production fossiles, il doit pousser à l’investissement dans les énergies bas-carbone, tout en restant technologiquement neutre. Avec les enjeux liés à la pénétration des énergies intermittentes, des solutions de marché sont également fréquemment mises en avant par les institutions européennes : les problèmes de congestion peuvent être réglés grâce à des prix locaux (Neuhoff, Karsten et al., 2024), tandis que la flexibilité de la consommation peut être encouragée avec une tarification de plus en plus dynamique.
Cependant, malgré les bénéfices associés à un fonctionnement du système électrique à l’échelle européenne, de nombreux économistes mettent en avant la distance qui existe entre le modèle théorique du marché et son fonctionnement en pratique (Cayla, 2023). Ces critiques ont été particulièrement virulentes après la crise énergétique de 2022. Le signal-prix est par exemple jugé insuffisant ou trop instable pour orienter efficacement les investissements (prix parfois trop faibles, volatilité extrême, absence de visibilité au-delà de quelques années). À cela s’ajoute la complexité du marché de détail, caractérisé par une profusion d’offres et d’options tarifaires peu lisibles pour les consommateurs. Les chocs récents ont révélé la capacité de ce système à générer des rentes exceptionnelles pour certains producteurs à faible coût, alimentant un sentiment d’iniquité et remettant en question la légitimité du cadre actuel.
3. Le fonctionnement du marché, un point de blocage particulièrement important en FranceEn France, les critiques du marché de l’électricité sont aussi anciennes que le marché lui-même. Au-delà de critiques portant sur les dysfonctionnements dudit marché, il existe une remise en cause de la légitimité de l’intégration du système électrique français au marché commun de l’électricité. Ces critiques sont plus profondes, et peut-être plus spécifiquement françaises : elles tiennent notamment au poids historique d’EDF et au coût marginal particulièrement faible de l’électricité nucléaire.
L’ouverture du « service public de l’électricité » à la concurrence a rencontré une résistance particulièrement forte en France. Encore aujourd’hui, le système électrique français est l’un des plus concentré en Europe. EDF, qui opère tout le parc électronucléaire français, produit plus de 70% de l’électricité du pays. Les tarifs réglementés de vente, régulièrement pointés du doigt par la Commission européenne comme une entrave à la concurrence, concernent encore une majorité des consommateurs résidentiels et une part significative des entreprises.
Le poids politique de l’opérateur historique est considérable, comme l’a récemment prouvé la résonnance dans le débat public des auditions de plusieurs anciens dirigeants d’EDF en décembre 2022, dans le cadre d’une commission d’enquête sur la perte de souveraineté énergétique de la France.
Part de marché du plus gros producteur d’électricité, 2023
Un deuxième point, qui tient également au nucléaire, est le faible coût marginal de production de l’électricité en France. Le couplage des marchés européens, combiné à une interconnexion croissante, conduit mécaniquement à une convergence entre le prix français et celui de ses voisins européens. Autrement dit, une augmentation du prix de l’électricité en France, un fait qui était déjà anticipé dès les années 2000 (Finon et Glachand, 2008). D’où des intérêts potentiellement divergents entre autorités françaises, soucieuses de préserver leur compétitivité, et institutions européennes qui poussent à l’intégration du réseau électrique européen.
La France a suivi le mouvement de l’Union de l’énergie, mais non sans de nombreuses résistances (Bocquillon et Evrard, 2016). La crise énergétique de 2022 est intervenue dans ce contexte, et a relancé le débat avec une nouvelle vigueur. Dans un récent rapport parlementaire de la Commission des Affaires Economiques, la méfiance envers le fonctionnement du marché est manifeste. Les rapporteurs soulignent les « lacunes » des marchés de l’électricité, qui « justifient une intervention publique ». Les tensions avec la Commission sont visibles, notamment au sujet des TRV, considérés par cette-dernière comme « transitoires ». Les rapporteurs appellent au contraire le gouvernement « défendre très fermement leur pérennisation », pour éviter d’exposer le consommateur à la volatilité du marché de gros.
Conclusion
La trajectoire française met en évidence une singularité profonde au sein de l’Union européenne : un mix électrique déjà largement décarboné, structuré autour de puissances pilotables nucléaires et hydrauliques, et un réseau robuste occupant une position centrale dans l’architecture électrique continentale. Cette situation constitue autant un atout majeur qu’un facteur de complexité dans un cadre européen largement structuré autour du développement massif des EnR et des objectifs d’intégration des marchés.
Dans ce contexte, les décideurs, à Paris comme à Bruxelles, doivent parvenir à concilier ces spécificités nationales avec l’ambition de construire une véritable Union de l’énergie. Cela implique non seulement de prendre en compte la diversité des modèles électriques européens, mais aussi d’adapter les instruments de planification, de financement et de régulation afin qu’ils soutiennent un système réellement bénéfique pour l’ensemble des États membres.
La question de la gouvernance devient alors cruciale : comment faire évoluer le cadre européen pour intégrer les différences structurelles entre pays, pour assurer la cohérence des investissements dans les réseaux ainsi que pour organiser une solidarité énergétique qui soit à la fois efficace, soutenable et politiquement acceptable ? À mesure que l’électrification progresse et que les réseaux deviennent le cœur battant de la transition énergétique, la réponse à cette question déterminera la capacité de l’Europe à faire émerger un système électrique résilient et véritablement décarboné. Un projet qui ne pourra réussir qu’en prenant pleinement en compte la singularité française.
Vincent Auffray & Pablo Gómez
Illustration : Giacomo Balla, Street Light, 1910-1911, huile sur toile, 174,7 × 114,7 cm.
À lire aussi :