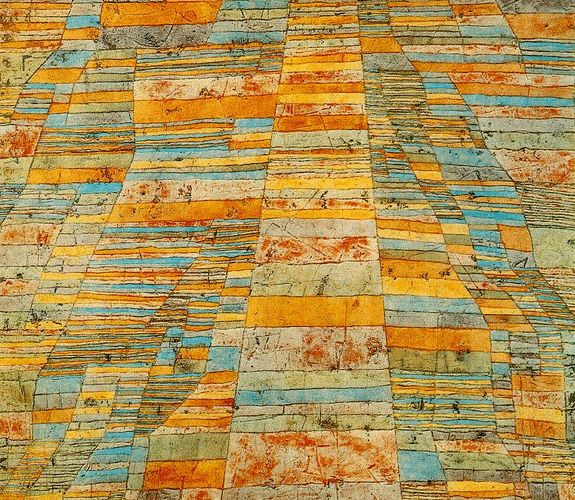Clément Carbonnier est économiste, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste des politiques fiscales comme levier de l’intervention publique. Dans son dernier ouvrage, Toujours moins ! L’obsession du coût du travail ou l’impasse stratégique du capitalisme français (La Découverte, octobre 2025), il interroge la remarquable continuité des politiques économiques françaises visant à abaisser le coût du travail pour stimuler l’emploi, notamment peu qualifié. Dans cet entretien il revient sur les origines de cette stratégie, ses contradictions internes et ses limites.
Introduction : une stratégie qui s’impose en plusieurs temps
Institut Avant-garde : Merci, Clément Carbonnier de faire cet entretien avec nous. La thèse principale de votre livre, c’est que, depuis les années 80, la politique économique française a cherché constamment à baisser le coût du travail. Pouvez-vous commencer par présenter succinctement cette stratégie et ses principales caractéristiques ?
Clément Carbonnier : Cette stratégie s’inscrit dans le contexte français, et notamment dans la stratégie qui a dominé après la Seconde Guerre mondiale, qui était une stratégie à la fois de planification, et de soutien à la croissance par la demande. On avait des politiques salariales plutôt favorables, à la fois à travers la négociation et à travers le salaire minimum, par rapport à d’autres pays.
On avait aussi une protection sociale qui était relativement développée, mais qui, en France, est bismarckienne, c’est à dire dans lequel le financement de la protection sociale se fait par les cotisations sociales, avec même une gestion au départ par le paritarisme.
Si on prend un peu techniquement les manières de faire baisser le coût du travail dans ce contexte-là, il y a trois grandes manières de faire. Soit on fait baisser les salaires nets, soit on fait baisser les cotisations sociales, mais dans ce cas, on a deux solutions. On peut changer le financement, c’est-à-dire que l’on continue à garder le même niveau de protection sociale, mais au lieu de la financer par des cotisations sociales, on la finance par autre chose. Ou alors on essaye de limiter le niveau de la protection sociale.
Historiquement, ce que j’essaye de montrer dans le livre, c’est qu’à partir des années 80, on a un ensemble de politiques qui vont essayer de faire baisser le coût du travail à travers ces trois manières.
La première, ça a été le changement du financement de la protection sociale dans le but justement de conserver le salaire net et le niveau de la protection sociale. Cela a consisté à baisser le coût du travail à travers des exonérations de cotisations et le remplacement de ces financements par des compensations sur les budgets de l’état, soit à travers des impôts existants, soit à travers la création de nouveaux impôts comme la CSG.
La deuxième, c’est de limiter le coût de la protection sociale. On pense à toutes les réformes de la protection sociale, en particulier les réformes des retraites, mais aussi beaucoup de réformes, peut être plus petites, et moins visibles d’une certaine manière, dans le domaine de la santé.
La troisième, c’est de limiter directement la croissance du salaire net, à travers des politiques, soit qui diminuent le pouvoir de négociation des salariés, soit qui créent des régimes dérogatoires au salariat, et notamment au salaire minimum.
« À partir des années 80, on a un ensemble de politiques qui vont essayer de faire baisser le coût du travail de trois façons : des exonérations de cotisations sociales, une limitation du coût de la protection sociale, ou, plus directement, de la croissance du salaire net. »
Une autre voie était-elle possible à l’époque ? Et quel est le lien entre l’émergence de ces politiques de baisse du coût du travail et la désyndicalisation ?
Vaste question ! Est-ce qu’une autre politique était possible à l’époque ? Il y a des enjeux politiques sur lesquels je n’ai probablement pas tous les éléments, mais économiquement, il y a des alternatives, notamment en termes de socialisation de la production. Un des enjeux qui est lié à tout ça, c’est la libéralisation de l’économie. C’est compliqué d’aller dans une voie très forte de libéralisation de l’économie sans chercher à faire baisser le coût du travail.
Sur les liens avec la syndicalisation, et in fine la désyndicalisation. Ils peuvent être assez directs, par exemple à travers la baisse de pouvoir de négociation des représentants des salariés, qui rend finalement les syndicats moins attrayants, puisqu’ils ont moins de pouvoir. Les lois, à proprement parler, qui diminuent ce pouvoir-là sont d’ailleurs plus récentes que le mouvement observé de désyndicalisation et donc le lien est aujourd’hui difficile à faire. Malgré tout, on a des formes de libéralisation, de financiarisation de l’économie, qui, en dehors de ces lois, vont réduire la capacité des syndicats à défendre les travailleurs et donc participent peut-être de ce point de vue-là à la désyndicalisation, mais ça reste des conjectures.
Parallèlement, il y a l’affaiblissement du paritarisme, en partie légal, qui a précédé la période dont je parle. Il y a notamment les ordonnances Jeanneney de 1967, qui réduisent finalement le pouvoir des syndicats sur la gestion de la Sécurité sociale et qui, potentiellement, ont pu affaiblir la position des syndicats dès ce moment-là. De la même manière, l’étatisation de la protection sociale participe de cette reprise en main des budgets de la Sécurité sociale, principalement pour les baisser. C’est très visible dans le cas de l’assurance chômage. On a, par exemple, la suppression des cotisations sociales salariées pour l’assurance chômage et dans la foulée, l’État qui augmente finalement sa pression sur les syndicats et les représentants patronaux avec des feuilles de route beaucoup plus contraignantes et qui, in fine, amènent l’État à prendre les décisions restrictives.
À quel moment on peut dire que la politique de baisse du coût du travail, cesse-t-elle d’être un ajustement conjoncturel à la crise du régime keynésien dans les années 70-80 et devient une véritable doctrine qui structure tout le modèle social français ? Et ensuite, quels effets de bord cela a sur les politiques sociales en général qui ne sont pas directement liées à ces politiques-là ?
Je ne crois pas que l’on puisse identifier un tel moment de fléchissement, même si c’est souvent attrayant de trouver un moment de rupture, une date clé. J’ai vraiment l’impression qu’on a un processus continu caractérisé par des phases d’accélération liées aux alternances politiques. C’est-à-dire qu’on a souvent des accélérations de ce processus avec l’arrivée au pouvoir de gouvernements de droite, par exemple en 1986. A cette date, on observe des prémices, où il est question de s’attaquer aux dépenses de santé, de retraite et plus globalement à l’ensemble des dépenses sociales visées nommément pour des raisons de coût du travail. On observe également une accélération sous Nicolas Sarkozy et, plus récemment, avec les deux quinquennats d’Emmanuel Macron, où là, on a presque un emballement.
Donc, on a plutôt des phases d’accélération, et non pas des ruptures claires. Sur l’emballement sous les quinquennats Macron, on voit qu’il y a beaucoup de choses qui ont été préparées, avec certes plus de débats et beaucoup plus de retenue, sous le quinquennat de François Hollande.
Pour conclure, je pense que ce qui se passe, c’est plus de l’ordre de la dépendance au sentier. Autrement dit, à force de le faire, ça devient la norme, et il y a donc une forme d’oubli que ça a pu être pensé comme conjoncturel à un moment donné. Il y a également, parfois, des constats d’échec, qui poussent contre-intuitivement ces gouvernements à aller plus loin dans cette voie.
« Je ne crois pas que l’on puisse identifier un moment de fléchissement, même si c'est souvent attrayant. J'ai vraiment l'impression qu'on a un processus continu caractérisé par des phases d'accélération liées aux alternances politiques. »
Dans ce contexte, est-ce qu’on peut considérer qu’il existe une cohérence de cette stratégie sur le temps long ? Ou alors, cette stratégie est-elle plutôt, accidentelle, contrainte, comme vous l’évoquez, par un sentier de dépendance qui pousse par la suite les gouvernements à aller de plus en plus loin ?
Je ne pense pas que ce soit un schéma réfléchi de manière cohérente, parce que, précisément, on voit des désaccords dans la manière de le faire, dans la vitesse des différentes réformes. D’une certaine manière, on peut dire qu’à travers les alternances, on continue, mais on ne continue pas de la même manière. Ce n’est pas un schéma global cohérent qui a été pensé depuis le début et qui est mis en place au fur et à mesure, mais ce n’est pas non plus totalement accidentel. Cette stratégie s’impose pour différentes raisons.
On peut identifier deux fils directeurs. Dans un premier temps, un fil directeur idéologique qui va faire que l’hypothèse de la centralité du coût du travail dans les questions d’emploi et de compétitivité internationale va s’imposer. Dès lors, les politiques qu’on va mettre en place vont chercher à répondre à ce que l’on considère comment étant « le problème ». Mais elles le font potentiellement de manière différente, car les gouvernements ont une sensibilité différente. Dans un second temps, un fil conducteur porté par des intérêts privés, par des gens qui ont intérêt à ce type de politiques. Ce qui caractérise aussi cette période, c’est quelque part un changement des rapports de force macroéconomiques. La cohérence est finalement à trouver derrière ces changements de rapport de force qui permettent à cette idée de centralité du coût du travail de s’imposer. Et à partir de là chacun va chercher des solutions différentes pour répondre à ce que tout le monde pense être « le problème ».
Les effets concrets des politiques de réduction du coût du travail
Institut Avant-garde : Une autre interrogation qui vient assez naturellement porte sur les effets concrets de cette politique de réduction du coût du travail. La première question, c’est, évidemment, est-ce que le coût du travail a bien baissé en France du fait de ces politiques ?
Clément Carbonnier : Alors, le coût du travail au niveau du SMIC a clairement baissé. Cela dit, il est toujours compliqué de mesurer le coût du travail, puisqu’il se mesure en euros et que l’euro n’a pas toujours la même valeur. Pour ce faire, dans le livre, j’observe le coût du travail au niveau du SMIC, incluant les cotisations sociales quand il y en a, et je regarde son évolution en l’indexant sur la croissance nominale par habitant. Ce que je vois, c’est que ces politiques ont très clairement amené à baisser le coût du travail. En tout cas, le coût du travail formel au niveau du salaire minimum.
Ensuite, le coût du travail pour les salariés au-dessus du SMIC est moins directement impacté. L’affaiblissement de la négociation salariale fait qu’on observe ce que les gouvernements récents ont appelé une « smicardisation ». C’est-à-dire que même si le SMIC a très peu augmenté, les salaires au-dessus ont encore moins augmenté, ce qui entraine un tassement de l’échelle des rémunérations.
On observe donc bien une baisse du coût du travail, pas uniquement au niveau du SMIC, mais aussi pour les salaires supérieurs.
« Ces politiques ont très clairement conduit à une baisse du coût du travail, en particulier au niveau du SMIC, et pas uniquement à ce niveau-là : on observe aussi une compression des salaires au-dessus, traduisant un tassement de l’échelle des rémunérations. »
Après le coût du travail, on peut s’interroger sur l’emploi. Sur le plan empirique, est-ce que ces politiques ont produit des effets attendus sur l’emploi ? Si non, pourquoi ?
Non, ces politiques n’ont pas produit les effets attendus sur l’emploi. Pour mesurer et contextualiser cette affirmation, on peut s’appuyer sur l’étude que j’ai mené à l’aide d’une équipe de chercheurs de Science Po et de la Banque de France sur l’évaluation du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE). L’avantage du CICE c’est qu’il présente un certain nombre de caractéristiques qui permettent de bien identifier ses bénéficiaires et, in-fine, de bien évaluer l’effet de la baisse du coût du travail sur l’emploi. Nous avons ainsi montré, de manière vraiment très certaine, qu’il n’y avait pas eu de créations d’emplois liées au CICE.
La question qui s’est posée à l’aune de ces conclusions c’est pourquoi cette absence d’effets sur l’emploi ? Un contre-argument qui est souvent revenu c’est :« oui, le CICE n’a pas eu les effets escomptés sur les salaires moyens, mais ça a eu des effets sur les bas salaires ». Dans le livre, j’ai donc décidé de constituer une revue de littérature sur les effets observés des politiques de baisse, ou de hausse du coût du travail d’ailleurs, au niveau du salaire minimum à travers des modifications des cotisations sociales dans un grand nombre de pays.
Ce qu’on observe, c’est que dans les pays qui ont des cotisations sociales relativement importantes, comme la France et les pays scandinaves, les politiques liées à des exonérations de cotisations n’ont pas eu, ou très peu, d’effets. L’histoire est vraie aussi dans l’autre sens, notamment dans des pays qui ont augmenté le niveau du salaire minimum.
Le résultat global pour l’ensemble de ces politiques-là, même s’il y a évidemment des exceptions, c’est qu’il y a très peu, voire pas, d’effets sur l’emploi des variations du coût du travail sur les bas salaires. Alors, évidemment, ces observations varient légèrement par rapport au niveau relatif du salaire minimum en comparaisons internationales. Mais pour les niveaux actuels des salaires minimums dans les pays les plus développés, dont la France, il n’y a pas d’effet fort du coût du travail sur l’emploi.
Alors, ça peut paraître contre intuitif puisque dans un modèle simple de marché du travail où les travailleurs vendent leur marchandise, leur « force de travail », à leur employeur, on se dit « si la marchandise est moins chère, les acheteurs en achètent plus » et donc normalement, l’emploi devrait augmenter. Pourtant, ce n’est pas ce qu’on observe. L’explication qui me semble la plus satisfaisante pour comprendre ce qui se passe c’est ce qu’on appelle « les mécanismes de complémentarités dans la production ». Basiquement, quand on est une entreprise, on ne produit pas avec une seule « sorte » de travail, et on ne produit pas non plus avec uniquement du travail.
Ce qui se passe donc, c’est que si une sorte de travail voit son coût augmenter, on ne va pas mécaniquement baisser cette quantité de travail là, on va plutôt répartir les coûts sur l’ensemble du mécanisme de production. De la même manière, quand l’électricité augmente, les boulangers ne vont pas réduire le temps de cuisson de leur pain, ils vont cuire autant leur pain, parce qu‘il a besoin d’un niveau de cuisson précis. Si la farine augmente, ils ne vont pas mettre moins de farine etc. En bref, ils vont répartir les coûts sur d’autres facteurs de production. De la même manière, si une « sorte » de travail voit son coût augmenter, en fait, on ne peut pas forcément le substituer dans la production, et donc ce qui va se passer, c’est que cette hausse du coût du travail va être distribuée peut-être en partie sur les prix, peut-être en partie sur les rémunérations d’autres facteurs, peut-être les profits, etc.
Pour bien avoir cette idée en tête, j’avais fait le calcul au moment des législatives 2024, où il y avait une proposition d’augmentation du SMIC de 14%. En prenant les données sectorielles, et en regardant sur les secteurs qui emploient le plus de salariés à bas salaires, typiquement, le commerce, le nettoyage, et en tenant compte de leur fonction de production, une hausse du SMIC de 14% augmentait leurs coûts globaux de seulement 0,6%. Et donc on voit bien qu’on a un effet, même si l’on considère que ça passe totalement par les prix, qui est relativement limité sur l’inflation et sur les coûts globaux. Ce n’est pas étonnant qu’il n’y ait pas d’effets forts sur l’emploi.
« Nous avons montré, de manière très certaine, qu’il n’y avait pas eu de créations d’emplois liées au CICE. Plus largement, pour les niveaux actuels du salaire minimum dans les pays développés, il n’existe pas d’effet fort du coût du travail sur l’emploi. »
À cette explication par la complémentarité des différents types de main-d’œuvre, est-ce qu’on ne peut pas y ajouter une explication par l’existence d’un niveau de pouvoir de marché et de rente sur le marché du travail de la part des employeurs ?
Cette explication, c’est notamment l’explication qui avait été beaucoup mise en avant il y a plusieurs années aux États Unis sur des études cherchant à mesurer l’effet des hausses du SMIC sur le niveau d’emploi et où il avait été montré que ces hausses ne détruisaient pas l’emploi, voire en créaient. C’est notamment l’étude pionnière d’AB. Kruger et D. Card, qui leur a valu le prix de la Banque de Suède et qui était effectivement une évaluation à la frontière entre le New Jersey et la Pennsylvanie, spécifiquement dans le secteur des fast-foods. Les auteurs ont montré à l’époque que la hausse assez forte du salaire minimum dans le New Jersey n’avait pas pénalisé l’emploi et l’avait, au contraire, augmenté. L’interprétation, c’était de dire que les fast-foods rationnent l’emploi, quitte à mal servir les gens, car ça leur permet d’avoir des salaires très bas et donc de faire plus de profits. Mais à partir du moment où on leur impose de payer mieux les gens, ils sont obligés de les payer mieux, et du coup ils ont moins de mal à trouver les serveurs, dont ils ont effectivement besoin, ce qui explique l’effet observé sur l’emploi des travailleurs au salaire minimum.
Cet argument a été utilisé en France dans le sens opposé en invoquant un coût du travail plus fort comparativement aux États Unis. L’argument dans le cas français était l’opposé de celui que je viens de mentionner : une variation du coût du travail, par exemple une hausse du SMIC, aurait des effets négatifs sur le taux d’emploi parce que le coût du travail est comparativement « plus élevé » en France. Le raisonnement fait sens, il est vrai qu’une hausse plus forte du SMIC n’aurait pas mécaniquement le même effet que celui documenté dans cette étude. Néanmoins, comme je l’ai montré auparavant, des hausses modérées, comme les 14% que j’ai mentionné, du SMIC en France n’entrainerait qu’une hausse de 0,6% des coûts globaux des entreprises fortement intensive en travailleurs payés au SMIC. Evidemment, si on doublait le SMIC du jour au lendemain, ça aurait probablement plus d’effet. Le niveau du Smic et l’ampleur de la hausse du coût du travail joue donc forcément. On ne peut pas les augmenter indéfiniment sans qu’il y ait d’effets. Néanmoins, au niveau du SMIC aujourd’hui en France, une hausse sensible de ce dernier n’aurait vraisemblablement pas d’effets négatifs.
Plus généralement, l’idée selon laquelle les différences de niveau de salaire entre la France et les États-Unis, et la présence supposée de monopsones aux États-Unis, invalideraient les effets positifs d’une hausse du salaire minimum sur l’emploi ne tient pas vraiment, pour deux raisons.
D’abord, parce que, depuis, le nombre d’études a augmenté : plusieurs États ont fortement relevé leur salaire minimum, parfois à des niveaux supérieurs à ceux pratiqués en France, en Californie ou dans l’État de New York par exemple, et il n’y a pas eu un impact négatif sur l’emploi.
Ensuite, sur l’argument des monopsones, la réponse habituelle consiste à dire : « S’il y avait vraiment une situation de monopsone, les entreprises feraient des profits énormes. Or, dans les faits, les entreprises qui recrutent au salaire minimum ne sont pas celles qui dégagent des profits colossaux. Ce ne sont pas les géants de la tech ou de la finance : ce sont souvent des commerces, des services, des chaînes de restauration, bref, des secteurs à faibles marges ».
On peut toutefois avancer un contre-argument : ces entreprises à bas salaires ne dégagent pas de profits, non pas parce qu’elles sont inefficaces, mais parce qu’elles sont elles-mêmes dépendantes de grandes entreprises, les donneuses d’ordre, et sont donc le relais de monopsones qui captent l’essentiel de la valeur. Dans ce cas, le “monopsone” se situerait en amont, dans la structure des relations de pouvoir économique entre firmes. C’est possible, et je ne dis pas que c’est faux, mais à partir de là, le raisonnement devient assez complexe, et peut-être trop pour en faire un cadre explicatif général.
En comparaison, l’argument de la complémentarité, si on s’en tient au principe du rasoir d’Ockham, me semble plus simple, plus cohérent et, au fond, plus convaincant pour expliquer ce qu’on observe empiriquement.
Votre livre expose un passage intéressant sur les maux du marché du travail français, où on passe de la déploration de l’existence de trappes à inactivité, à celles de trappes à bas salaires. Comment se fait ce mouvement et quel est le lien avec les politiques de baisse du coût du travail ?
Effectivement, parmi les arguments utilisés à travers le temps qui ont permis d’ancrer cette idée qu’il fallait baisser le coût du travail, il y a celui des trappes à inactivité. On expliquait que, d’un côté, le coût du travail était trop élevé pour les employeurs, ce qui freinait l’embauche, et que, de l’autre, la protection sociale était trop généreuse pour les personnes sans emploi, ce qui réduisait les incitations à travailler. Cette double lecture, coût du travail trop haut, prestations sociales trop confortables, a beaucoup influencé les politiques publiques. Et même si certaines mesures ne relèvent pas directement de la politique du coût du travail, elles en sont proches dans leur logique. Dans le livre, je donne l’exemple de la prime d’activité : officiellement, c’est une politique de pouvoir d’achat, pas une politique de coût du travail. Mais, dans les faits, elle est très liée à cette logique. L’idée de départ, c’est : “le travail ne paie pas”. Puisqu’on a comprimé les salaires, il faut que “le travail paie” pour inciter à l’emploi, mais sans faire peser le coût sur les employeurs. Donc, plutôt que d’augmenter les salaires, on verse un complément public aux travailleurs à bas salaires.
On a vu cette logique très clairement au moment du mouvement des Gilets jaunes. Quand Emmanuel Macron prend la parole à la télévision, il dit « je vous ai compris, je vais agir » et ce qu’il promet c’est “100 euros de plus pour les travailleurs au SMIC”. Evidemment, il n’a jamais dit « on va augmenter le SMIC de 100€ », parce que cela aurait relevé le coût du travail. À la place, il revalorise la prime d’activité, financée par l’État. C’est typiquement ce genre de mesure qui fait le lien entre coût du travail et politique de pouvoir d’achat : on soutient le revenu sans toucher au salaire brut, donc sans affecter la compétitivité des entreprises. Mais ce système a un coût budgétaire énorme. Soit l’État paye les cotisations sociales à la place des employeurs, soit il verse directement une part du salaire via la prime d’activité. Dans tous les cas, la facture est publique. Et malgré cela, ce n’est pas suffisant pour augmenter le niveau de vie des travailleurs à bas salaires qui continuent à se « plaindre », notamment de la smicardisation. Et là, au lieu de remettre en question l’ensemble des réformes qui ont affaibli le pouvoir de négociation des travailleurs, le discours dominant reste dans une logique d’incitations. On explique que si les salaires stagnent, c’est à cause d’un “mur d’incitation” : les employeurs seraient découragés d’augmenter les salaires à cause des taux marginaux d’imposition trop élevés.
Mais cette interprétation arrange bien les tenants des politiques de baisse du coût du travail, parce qu’elle permet de renvoyer la responsabilité vers “les prélèvements obligatoires”. Autrement dit, si les salaires sont bas, ce ne serait pas à cause de la compression salariale, ni de la faiblesse du rapport de force des travailleurs, mais à cause d’un système fiscal et social trop lourd. Alors qu’en réalité, ces fameux “taux marginaux d’imposition élevés” sont le résultat direct de cette stratégie de baisse du coût du travail, pas sa cause.
« On est passé du discours sur les “trappes à inactivité” à celui sur les “trappes à bas salaires” […]. On explique que le travail ne paie pas, mais au lieu d’augmenter les salaires, on verse un complément public aux travailleurs à bas revenus, sans faire peser ce coût sur les employeurs. »
Vous l’avez déjà un peu dit, mais quels sont les effets sur les inégalités de ces politiques de baisse du coût du travail ?
Globalement, les politiques de baisse du coût du travail ont toutes des effets inégalitaires, mais par des mécanismes différents. Au début, j’expliquais qu’il y a trois grandes manières de réduire le coût du travail, et chacune d’elles tend à creuser les inégalités, mais pas pour les mêmes raisons. Si on les prend dans l’ordre inverse, parce que c’est peut-être plus clair.
D’abord, l’axe du salaire net : quand on limite les hausses de salaires, surtout pour les bas salaires, on accroît mécaniquement les inégalités. Les salaires élevés, ou les profits, sont beaucoup moins affectés, alors que les bas salaires voient leur pouvoir d’achat stagner. Le résultat, c’est un écart qui se creuse.
Ensuite, si on considère la protection sociale : la réduire, par une non-compensation des cotisations perdues, a aussi des effets inégalitaires, suivant les manières dont on fait baisser la protection sociale. Les plus aisés peuvent assez facilement se tourner vers des assurances privées ou d’autres formes de couverture, alors que les plus modestes n’ont pas cette possibilité. Pour eux, la baisse de la protection publique se traduit soit par une perte de droits, soit par un coût très élevé s’ils veulent se couvrir autrement. Là encore, les inégalités augmentent.
Enfin, le financement des baisses de cotisations a lui aussi un effet sur les inégalités, même si ce n’est pas toujours perçu comme tel. On pourrait penser que ce levier est neutre puisqu’il s’agit de “compenser” les exonérations, mais en pratique, il ne l’est pas du tout. Il y a d’abord l’exemple du CICE : on avait baissé non pas les cotisations directement, mais les impôts sur les sociétés liés à la masse salariale.
Résultat : ça n’a pas créé d’emplois supplémentaires, ni augmenté les bas salaires. En revanche, ça a amélioré les marges des entreprises, augmenté les revenus des actionnaires, et même, dans certains cas, les salaires des plus qualifiés. Autrement dit, l’incidence de cette subvention bénéficie aux détenteurs du capital et aux salariés les mieux rémunérés, mais pas à ceux qu’on voulait cibler. Là encore, l’effet est inégalitaire.
Le deuxième canal de cette question de financement passe par la compensation budgétaire. Quand l’État réduit les cotisations sociales, il doit compenser la perte pour la Sécurité sociale par son budget. Et donc là, il a deux manières possibles de le faire : soit en réduisant ses propres dépenses, ce qui se traduit souvent par une contraction des services publics, qui sont pourtant très redistributifs ; soit en augmentant d’autres impôts, comme la TVA ou la CSG, qui sont anti-redistributifs. Dans les deux cas, la conséquence est la même : les ménages modestes sont plus touchés que les plus aisés.
Finalement, qu’on agisse sur les salaires, la protection sociale ou le financement compensatoire, la logique de baisse du coût du travail tend à accroître les inégalités, simplement par des voies différentes.
« Le résultat, c’est que ça n’a pas créé d’emplois supplémentaires, ni augmenté les bas salaires. En revanche, ça a amélioré les marges des entreprises, augmenté les revenus des actionnaires […] : l’incidence de cette subvention bénéficie aux détenteurs du capital et aux salariés les mieux rémunérés, mais pas à ceux qu’on voulait cibler. »
Pour aller plus loin : est-il possible de s’extraire de cette stratégie ?
Institut Avant-garde : Pour ouvrir la discussion, la première question importante qui vient à l’esprit est la suivante : Est-ce que la stratégie de baisse du coût du travail n’était pas inévitable dans un contexte de transition démographique vu que le vieillissement pousse le niveau de cotisations à monter mécaniquement ?
Clément Carbonnier : Un des arguments qu’on entend souvent pour dire que cette stratégie était « inévitable » et que la hausse de la protection sociale serait “insoutenable”, c’est justement l’idée que cette dépense croît plus vite que le PIB. Et c’est vrai : la protection sociale augmente non seulement avec la croissance du PIB, mais aussi dans le PIB, c’est-à-dire qu’elle en représente une part croissante. C’est ce que certains appellent la loi de Wagner, et on l’observe effectivement depuis plusieurs décennies. Cette progression s’explique principalement par deux grands postes : les retraites et la santé. Pour les retraites, le mécanisme est assez clair : avec le vieillissement de la population, il y a plus de retraités par rapport aux actifs, donc plus de pensions à financer. Pour la santé, on invoque souvent ce même vieillissement, ce qui est vrai, car les personnes âgées ont davantage recours aux soins, mais ce n’est pas la seule cause. Il y a aussi les gains de productivités en santé, on est capable de mieux soigner un cancer aujourd’hui mais ça coûte évidemment bien plus cher que de simplement soulager la douleur comme on le faisait autrefois. Les gains de productivité médicale entraînent donc une hausse du coût global des soins, même s’ils améliorent considérablement la qualité et la durée de vie.
Derrière tout cela, la vraie question, c’est : est-ce soutenable ? Et là, d’un point de vue macroéconomique, il existe un argument assez simple : techniquement, oui, ça peut l’être. Certes, on aura moins d’actifs et plus de retraités, mais le PIB par habitant, et pas seulement par travailleur, qui inclut donc ces inactifs-là, continue d’augmenter. Autrement dit, même avec un ralentissement de la croissance, il est tout à fait possible de maintenir un niveau de vie moyen en hausse, y compris pour les actifs, tout en finançant davantage de retraites et de dépenses sociales.
Donc, ce n’est pas une impossibilité économique, c’est un choix de société. On peut décider collectivement de consacrer une plus grande part de la richesse produite à la santé, aux retraites, à la protection sociale. Ou au contraire, de limiter cette part. Et au-delà, on pourrait aussi envisager des politiques qui redéfinissent ce qu’on produit et pour quoi faire, en cherchant à améliorer le bien-être plutôt que le seul PIB marchand. Ces stratégies sont évidemment plus complexes à mettre en œuvre, mais au moins, d’un point de vue strictement économique, rien n’impose que la hausse de la protection sociale soit insoutenable. Tant que le PIB par habitant progresse, c’est techniquement possible.
Dans votre livre, vous décrivez un « triangle d’impossibilité » entre hausse des salaires, baisse du coût du travail et réduction du soutien public. Est-ce une fatalité aujourd’hui, (à cause du cadre européen, de la démographie, du niveau de la dette publique française, de la dépendance au sentier, etc…) ou peut-on encore s’en extraire ?
Je pense qu’on peut tout à fait s’en extraire, d’autant plus qu’elle fait désormais peser tellement de contraintes qu’elle finit par se retourner contre elle-même. On le voit bien, même les tenants historiques de cette politique commencent à envisager, certes très modestement, d’en réduire la portée. Si on regarde les exonérations de cotisations sociales, par exemple, on n’est plus dans une dynamique d’augmentation continue. Elles commencent à diminuer légèrement, trop peu, à mon sens, mais c’est tout de même un signal. C’est la preuve que le système est arrivé à un point de tension, ce triangle pèse tellement, budgétairement et socialement, qu’il pousse même ses défenseurs à admettre, à demi-mot, la nécessité d’en sortir. Après, évidemment, cela reste avant tout une décision politique. Techniquement, rien ne nous empêche de rompre avec ce modèle.
On sait aujourd’hui qu’une hausse du coût du travail n’entraîne pas nécessairement de pertes d’emplois ou de frein à l’activité économique. Et à l’inverse, on fait face à des besoins criants de financement des services publics essentiels, qui ne sont pas seulement des sources de bien-être, mais aussi des moteurs de productivité pour l’économie dans son ensemble.
En résumé, le vrai piège n’est pas économique, c’est un piège politique que nous nous sommes imposé à nous-mêmes, et dont il est tout à fait possible de s’extraire.
« Quand on regarde les faits, cette politique ne tient pas ses promesses. La question est donc : pourquoi persiste-t-on ? Soit parce qu’on refuse de voir la réalité, soit parce qu’il y a des intérêts matériels en jeu […]. Et cette inertie est renforcée par une idéologie simple et séduisante : “si le travail coûte moins cher, il y aura plus d’emplois.” »
Si une voie de passage existe, pourquoi celle-ci n’est pas empruntée par les décideurs politiques aujourd’hui ? Est-ce une question d’intérêts ou d’idéologie ? Ou bien une combinaison de ces deux éléments ?
Oui, en fait, il y a deux pistes que j’explore dans le livre pour expliquer pourquoi on s’entête à poursuivre cette politique. Parce que, quand on regarde les faits, elle ne tient pas vraiment ses promesses, donc la question, c’est plutôt pourquoi persiste-t-on ?
Il y a deux grandes explications possibles. La première, c’est l’idéologie. On continue parce qu’on refuse de voir la réalité, parce qu’on reste attaché à un schéma de pensée, même quand les faits le contredisent. Et la seconde, c’est qu’il y a des intérêts matériels en jeu. Tout le monde ne perd pas avec cette politique, certains y gagnent, et ils ont donc tout intérêt à ce qu’elle se poursuive même si, globalement, elle a des effets négatifs sur l’économie. Et c’est là que la question devient politique : pourquoi ces “gagnants”, qui sont relativement peu nombreux, parviennent-ils à gagner la bataille politique ? Il y a sans doute des raisons liées à leur pouvoir d’influence, à leur poids médiatique, à leur capacité à faire entendre leur voix.
Mais il y a aussi autre chose. Au-delà de leur lobbying et de leur pouvoir d’influence, il y a des gens qui n’ont pas forcément intérêt à ce modèle, mais qui vont être facilement convaincu. Et ça, c’est le rôle de l’idéologie. Soit, parce que l’argument paraît simple et intuitif finalement qu’on pourrait résumer ainsi : “si le travail coûte moins cher, il y aura plus d’emplois.”
C’est un raisonnement séduisant, facile à comprendre, et donc très persuasif. On a beau savoir aujourd’hui que ce n’est pas vraiment comme ça que fonctionne le marché du travail, cette idée reste ancrée, parce qu’elle est simple et répétée en permanence. Et puis, il y a aussi un effet de formation. Moi-même, comme beaucoup d’économistes, j’ai été formé sur des modèles qui disaient que ça devait marcher en théorie. Quand on a été formé par ces cadres-là, il est plus difficile de croire aux évidences empiriques contraires. Et comme c’est cette vision de l’économie qui prédomine aujourd’hui, les non-économistes, les journalistes ou encore les décideurs reçoivent les informations économiques à travers cette grille de lecture dominante, ce qui entretient une inertie idéologique très forte malgré les preuves empiriques qui contredisent ce schéma de pensée.
Mais j’ai le sentiment que, du fait des contraintes actuelles, quelque chose est peut-être en train d’évoluer. Le “triangle d’impossibilité” que je décris dans le livre est aujourd’hui tendu au maximum et ne tient plus vraiment. Et cette tension pousse certains à reconsidérer les arguments. Il y a donc sans doute un petit mouvement de bascule, au moins sur le plan des idées. Mais il reste fortement freiné par le lobbying très puissant des entreprises et des actionnaires, et on le voit d’ailleurs clairement dans les débats budgétaires actuels.
Merci beaucoup d’avoir répondu à nos questions.

Clément Carbonnier est économiste, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste en économie publique appliquée. Ses travaux portent sur l’usage des instruments fiscaux comme leviers directs de mise en œuvre des politiques publiques. Il s’intéresse plus largement aux effets économiques et institutionnels de ces politiques, en analysant la manière dont elles transforment le cadre de l’État-providence. Son dernier ouvrage, Toujours moins ! L’obsession du coût du travail ou l’impasse stratégique du capitalisme français (La Découverte), est sorti en octobre 2025.
Image : Paul Klee, Highway and Byways (Hauptweg und Nebenwege), huile sur toile, 1929.
A lire aussi :