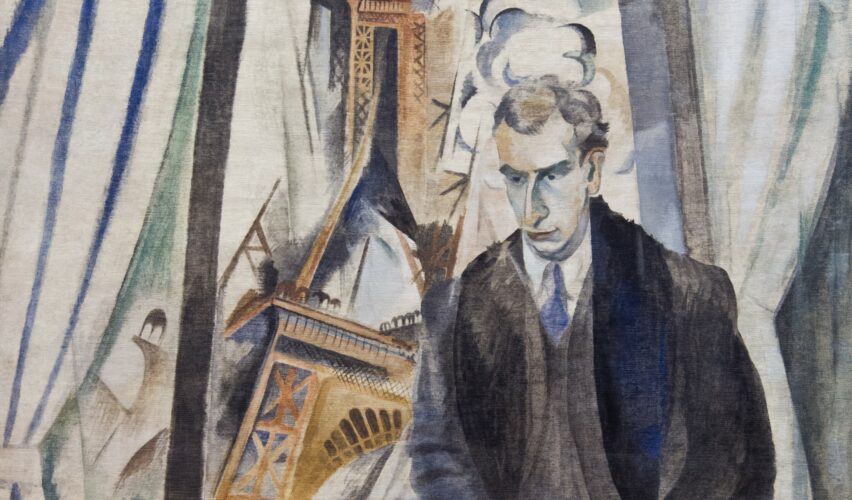Lors d’une table ronde organisée par la ville de Paris le 5 mai 2025, les résultats d’un rapport de l’OFCE sur l’évaluation du Plan Climat de la ville ont été présentés. Le rapport met en lumière l’ambition et la radicalité d’un tel plan mais aussi l’ampleur des investissements nécessaires pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, notamment dans les secteurs du bâtiment et des transports. Bien que non rentable financièrement au moins à court terme, cette transition s’avère socialement bénéfique lorsqu’on prend en compte ses cobénéfices. Les discussions ont souligné les défis techniques, sociaux et financiers à surmonter, ainsi que, de manière plus générale, le rôle clé des collectivités locales dans la transition. Les intervenants ont insisté de façon unanime sur l’urgence d’un engagement fort de l’État et d’une coordination accrue entre échelons locaux, régionaux et nationaux pour concrétiser les objectifs climatiques et permettre leur financement à l’échelle locale.
Ce lundi 5 mai, la Mairie de Paris a organisé une table ronde à l’occasion de la présentation des résultats du rapport d’évaluation du Plan Climat de la ville de Paris réalisé par l’OFCE : « La transition climatique sur le territoire parisien : impacts financiers et bénéfices associés ». Ce Plan, adopté par le conseil de Paris en novembre 2024, est constitué de 400 mesures qui visent à intensifier les efforts de la capitale dans la lutte contre le changement climatique et à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
En introduction, Xavier Timbeau, directeur de l’OFCE, n’a pas manqué de rappeler l’ambition de ce plan (par son objectif de neutralité carbone en 2050) mais également sa radicalité (par ses choix de sobriété et l’accélération inédite de sa stratégie de transition énergétique). Ce plan repose en effet sur un effort massif de décarbonation des transports et des bâtiments résidentiels et tertiaires. L’objectif intermédiaire est une réduction de 65% des émissions d’ici 2030 par rapport à 2004, et 94% d’ici 20501. La majeure partie de cette baisse serait liée au secteur du bâtiment (décarbonation du chauffage, isolation), et au secteur du transport (électrification du parc de véhicules, report modal vers les mobilités douces et les transports en commun).
S’en est suivie une discussion entre les auteurs du rapports2, les élus et les représentants d’institutions concernées au premier chef par le déploiement du plan.
Un plan rentable… si l’on prend en compte les cobénéfices
L’un des points centraux des discussions a été le coût financier, considérable, de cette transition. Les dépenses supplémentaires pour atteindre les objectifs fixés par la Mairie sont ainsi estimées à 2 milliards d’euros par an jusqu’à 2030, puis 1,5 milliard d’euros par an entre 2030 et 2050. Ce surcoût devra être réparti entre le secteur public, les ménages et les entreprises privées.
Pour la Ville de Paris, l’effort est évalué à environ 500 millions d’euros par an, dont 200 seraient affectés rien qu’à la rénovation de son parc immobilier et 200 autres aux subventions dédiées aux ménages et aux bailleurs sociaux. Le surcoût pour le secteur privé est estimé à 630 millions d’euros par an entre 2030 et 2050. Enfin, les ménages parisiens, devraient, quant à eux, faire face à un surcoût annuel estimé à environ 580 millions d’euros par an, soit une moyenne d’environ 12 500 € par ménage et par an.
Autre conclusion centrale du rapport : cette transition n’est pas nécessairement rentable d’un point de vue strictement privé et financier. Plusieurs projets spécifiques de décarbonation représentent en effet un coût supérieur à leur gain financier. Cet aspect est cependant contrebalancé si l’on adopte une analyse en termes de rentabilité sociale. En intégrant les nombreux cobénéfices de la transition du territoire parisien (par exemple, les gains sur la santé liés à l’amélioration de la qualité de l’air, à la réduction du bruit, la diminution du nombre d’accidents grâce au développement de la mobilité douce, etc.), le Plan Climat devient alors économiquement rentable. Les bénéfices sociaux à l’abattement sont estimés à 500€ par tonne de CO2.
De plus, des simulations macroéconomiques réalisées avec le modèle ThreeME de l’Ademe/OFCE anticipent d’autres effets positifs. La transition pourrait générer une hausse de la valeur ajoutée de 1,7 Md€ en Île-de-France et 3 Md€ pour la France entière, avec un multiplicateur national compris entre 1 et 1,5. La création d’emplois est également un enjeu clé. Le Plan Climat parisien pourrait générer environ 16 000 emplois par an en Île-de-France (et environ 26 000 emplois par an en France). En 2030 en Île-de-France, les créations d’emplois se concentreraient dans le secteur de la construction (+10 000 emplois) et dans les services (+9 000).
Selon l’OFCE, ces bénéfices justifient l’effort financier global mais nécessite immanquablement l’intervention publique, sans laquelle les investissements ne se déclencheront pas. Les analyses du Secrétariat Général la Planification Écologique (SGPE) vont dans ce sens : elles ont récemment montré qu’un tiers des leviers de décarbonation ne sont pas rentables et sont portés par des acteurs qui n’ont pas la capacité financière à les réaliser.
Le rôle crucial des collectivités locales et la question de leur financement
En plus de ces aspects purement financiers, le rôle essentiel des collectivités locales dans la réussite de la transition énergétique a été mis en exergue. En effet, elles possèdent des compétences clés, une capacité d’entraînement des acteurs locaux et apportent des réponses territorialisées aux problèmes. Mais elles font face à un manque crucial de ressources techniques et à un besoin croissant de solidarité entre territoires… Cette question se pose pour Paris, qui doit agir de concert avec sa banlieue. Le rapport de l’OFCE va ainsi dans le sens des conseillers municipaux présents : si la ville a certes accéléré le financement de sa transition, elle ne pourra le faire complètement seule.
Qui plus est, la mise en place du Plan doit faire face à des obstacles d’ampleur, communs à d’autres municipalités. La réforme de la fiscalité locale, notamment la suppression de la taxe d’habitation, a drastiquement limité le levier fiscal. De plus, la capacité des collectivités à maintenir des trajectoires d’investissement ambitieuses et à l’augmenter se heurte à un manque de lisibilité financière sur le long terme. Le recours à l’endettement est une solution envisagée pour faire face aux besoins additionnels et aux difficultés budgétaires. Le rôle des banques publiques comme la BEI (Banque Européenne d’Investissement) pourrait alors être crucial pour garantir des financements caractérisés par des maturités longues et une rentabilité incertaine au moins à court-terme. Deux points sur lesquels nous avions nous-même insisté dans de précédentes publications de l’Institut3. Ainsi, l’efficacité de la prise en charge de la transition à l’échelle territoriale dépend des soutiens nationaux, voire européens, apportés aux collectivités.
Défis, contraintes et points d’attention
Cette table ronde a été l’occasion de souligner l’apport de l’approche coûts-bénéfices transposée localement par l’OFCE, ainsi que l’enjeu d’exemplarité auquel fait face la ville de Paris : bien que représentant une part minoritaire des émissions nationales, son succès individuel demeure crucial pour encourager les autres communes du pays à adopter des plans similaires.
La très grande ambition du Plan Climat de Paris ne va pas sans un certain nombre de défis à relever et de contraintes à prendre davantage en compte. Jean Pisani-Ferry, qui était présent pour discuter des résultats de l’étude, a identifié un certain nombre de points d’attention pour ouvrir la discussion.
Premièrement, sur les effets macroéconomiques anticipés, l’ancien commissaire de France Stratégie a rappelé que ces créations d’emplois concernent souvent des métiers déjà en tension, notamment dans le bâtiment, posant la question de la qualification et surtout de la disponibilité de la main-d’œuvre. La mise en œuvre du plan ne pourra se faire sans un effort de formation.
Deuxièmement, des mesures comme l’interdiction des véhicules thermiques dans Paris en 2030, qui prend d’ailleurs les devants sur l’objectif européen de verdissement du flux de véhicules d’ici 2035, pose des questions d’acceptabilité politique, particulièrement pour les résidents franciliens qui ne bénéficieraient pas des mêmes aides que les parisiens, mais sont pourtant le plus souvent contraints d’entrer quotidiennement dans la capitale On retrouve ici un débat qui se pose de façon plus large avec les ZFE.
Enfin, des contraintes techniques et physiques fortes limitent également certaines solutions. La décarbonation des bâtiments présente ainsi de nombreux obstacles. Certaines sont communes à de nombreuses villes de France (copropriétés, asymétrie d’information entre les acteurs du secteur) quand d’autres sont plus spécifiques à Paris (les contraintes architecturales liées au patrimoine parisien empêchant l’isolation par l’extérieur, par exemple).
Ainsi, les résultats optimistes issus de la modélisation (rentabilité sociale, création d’emplois, etc.) ne doivent pas faire oublier que la mise en place du plan doit être accompagné d’actions concrètes et d’un engagement sur le temps long pour surmonter certains défis persistants. Du point de vue du financement, les analyses convergent : le renforcement des moyens des collectivités locales, l’amélioration de la lisibilité budgétaire et l’accès facilité à la dette verte sont apparus comme des conditions essentielles à la réussite de cette transition.
Noé Duvivier et Louna Duyck
Image : Robert Delaunay, Le poète Philippe Soupault, huile sur toile,1922, Centre Pompidou
[1] Les émissions résiduelles en 2050 (6%) seraient liées à la production de chaleur urbaine.
[2] Valentin Laprie, Anne Épaulard et Gissela Landa.
[3] Voir, en particulier, la section « Le financement des collectivités locales » du rapport « La boîte à outils du financement de la transition » ainsi que le croquis consacré au rôle des banques publiques dans la transition.
A lire aussi :