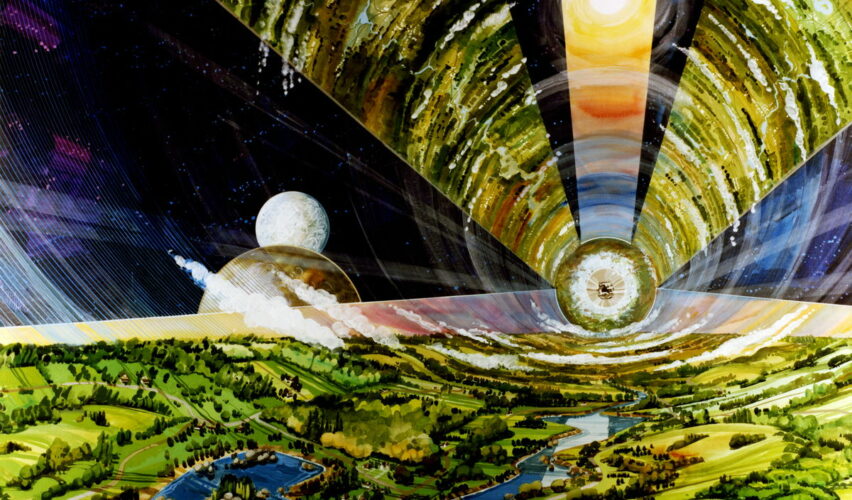Dans cette note, Anne-Laure Delatte (CNRS, Université Paris-Dauphine PSL) s’attache à prendre en compte l’hétérogénéité des multiplicateurs fiscaux et met en valeur leur importance dans l’évaluation de la trajectoire budgétaire française. En différenciant les effets des dépenses publiques et des mesures fiscales selon leur nature, l’autrice propose une stratégie budgétaire qui pourrait concilier financement des investissements prioritaires (climat, défense, santé, éducation, justice) et soutenabilité budgétaire.
La trajectoire des finances publiques françaises fait aujourd’hui l’objet de nombreux exercices de simulation. Le Conseil d’analyse économique, l’OFCE ou encore l’Institut Avant-garde ont ainsi modélisé différents scénarios de trajectoire de dette publique, en fonction de la taille et de la vitesse de l’ajustement budgétaire. Ces travaux convergent pour souligner un dilemme central : comment maintenir la soutenabilité de la dette publique tout en préservant la croissance économique et la capacité à financer des priorités stratégiques — transition écologique, défense, capital humain.[1]
Toutefois, une limite majeure subsiste dans ces analyses : elles traitent systématiquement le multiplicateur budgétaire comme un paramètre donné, généralement fixé dans une fourchette étroite (entre 0,75 et 1). Or, la valeur du multiplicateur dépend en réalité de la nature des mesures retenues. D’un point de vue théorique, la littérature keynésienne montre que l’impact sur l’activité est plus fort lorsqu’il s’agit de variations de dépenses publiques que de recettes fiscales. D’un point de vue empirique, des modèles macroéconomiques comme Mésange, développés par l’INSEE et la DG Trésor, estiment justement des multiplicateurs différenciés selon les « chocs » budgétaires considérés : investissement public, baisse des transferts, modification du système fiscal, etc.
L’intuition au cœur de cette note est la suivante : certaines mesures, parce qu’elles portent sur des postes dont l’effet multiplicateur est faible, peuvent réduire l’impact récessif global d’un ajustement budgétaire ; et certaines mesures budgétaires peuvent non seulement réduire l’impact récessif de l’ajustement, mais aussi l’inverser. Une augmentation de dépenses financée par une hausse de recettes peut, grâce à un multiplicateur plus élevé côté dépenses que côté recettes, générer un effet net positif sur l’activité. Autrement dit, les gains de croissance et de recettes fiscales associés à l’impulsion budgétaire peuvent plus que compenser le coût initial de la consolidation, et contribuer ainsi à améliorer le solde primaire conjoncturel. Il existe donc un chemin qui permettrait d’améliorer la soutenabilité sans sacrifier les investissements publics nécessaires. Encore faut-il identifier les marges de manœuvre possibles.
La démarche proposée dans cette note consiste à affiner l’évaluation des trajectoires budgétaires en liant explicitement chaque mesure fiscale ou budgétaire à la valeur de son multiplicateur. Cela permet d’identifier des combinaisons de mesures réalistes qui préservent la soutenabilité de la dette tout en minimisant — voire en neutralisant — les effets récessifs.[2]
Dans ce cadre, la note propose une méthode en trois étapes : d’abord recenser les marges budgétaires et fiscales disponibles à partir des évaluations de l’administration fiscale, des rapports publics et des travaux académiques ; ensuite estimer l’effet multiplicateur moyen des mesures retenues en mobilisant les valeurs issues du modèle Mésange, modèle d’économie française, développé par l’Insee et le Trésor ; enfin intégrer leurs effets agrégés dans la trajectoire du solde primaire et de la dette publique française.
1. Un état des lieux des marges de manœuvre et des besoins
A. Les marges de manœuvre
L’identification des mesures en matière de recettes et de réduction de dépenses repose sur une revue systématique des rapports publics et des travaux produits entre 2015 et 2025 par l’administration et la recherche appliquée. Du côté institutionnel, je mobilise les analyses du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), de la Cour des comptes, de France Stratégie, de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’INSEE. Ces travaux sont complétés par les contributions de la recherche appliquée, en particulier celles de l’Institut des politiques publiques (IPP), Institut de l’Economie pour le Climat (I4C) et l’EU Tax Observatory. Enfin, plusieurs rapports publics spécifiques nourrissent l’inventaire des réformes possibles, notamment le rapport Bozio-Wasmer sur les exonérations de cotisations sociales, le rapport du CNEPI sur le crédit impôt recherche et la note du CAE sur l’héritage. L’ensemble de ces sources fournit une base détaillée et quasi exhaustive des options fiscales et budgétaires disponibles.
Pour limiter l’effet récessif des ajustements budgétaires, il convient de sélectionner avec soin les instruments mobilisés. L’idée directrice est de concentrer les hausses de prélèvements et les réductions de dépenses sur des dispositifs peu performants, associés à de faibles multiplicateurs, et dont la suppression ou la modification n’entraîne qu’un impact limité sur les ménages les plus fragiles ou sur ceux dont la consommation réagit fortement au revenu disponible. Par exemple, on exclut une hausse d’un point de TVA (qui rapporterait entre 6 et 8,2 Mds par an mais affecterait surtout les ménages à bas revenus à forte propension marginale à consommer), la hausse d’un point du taux de CSG (14,6 Mds Euros), le gel total du barème IR (1,8 Mds), le retour du taux d’IS de 25 à 33% (4,4 Mds) au profit d’une réduction ciblée de dépenses fiscales qui permettent d’augmenter le taux effectif d’imposition sur les bénéfices ou sur le revenu avec un effet réduit sur l’économie.
i) Réduction de dépenses fiscales : 43,4 Mds, soit 1,5% du PIB 2025
Une première série de mesures vise à élargir l’assiette fiscale en réduisant/supprimant certains avantages fiscaux existants dont l’évaluation a montré la faible efficacité.
En effet, les exonérations ciblent des secteurs ou des ménages à forte propension à consommer ou à investir, de sorte que l’effet positif attendu sur l’activité doit compenser les pertes de recettes. Toutefois, certaines niches entraînent un manque à gagner budgétaire élevé pour un impact économique limité. C’est notamment le cas du CIR, dont les bénéfices se concentrent largement sur les grandes entreprises, alors même que son effet sur l’investissement et l’activité reste peu documenté (Rapport du CNEPI, 2021). Recentrer le dispositif sur les PME reviendrait, de facto, à réduire l’avantage fiscal dont bénéficient les grandes entreprises — autrement dit, à rapprocher leur taux effectif d’imposition de son niveau théorique — pour un coût macroéconomique attendu relativement faible.
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des mesures de réduction des dépenses fiscales retenues dans la simulation macroéconomique, classées par impôt concerné, avec l’estimation des recettes associées et la source de leur évaluation. Les notes de bas de page apportent des précisions complémentaires pour certaines dépenses fiscales, notamment sur leur périmètre et leur mode d’évaluation. Sont inclues des dépenses fiscales largo sensu dans la mesure où certaines exemptions comme celle concernant la TICPE ne sont pas considérées comme des dépenses fiscales par l’administration.
Côté IS, les mesures incluent le recentrage du crédit d’impôt recherche (CIR) sur les seules PME et la limitation du mécénat d’entreprise à une simple déductibilité.
Côté impôts sur la consommation (TVA, TICPE), la simulation retient le rétablissement du taux normal de TVA (20 %) dans la restauration, ainsi que la suppression des régimes dérogatoires applicables à l’aviation, au gazole et au maritime. Côté ménages (IR), la déduction des pensions est plafonnée pour les 10 % de retraités les plus aisés, la CSG sur les pensions est progressivement alignée sur le taux de droit commun pour les revenus les plus élevés, et plusieurs niches fiscales sont supprimées — notamment celles liées à la prime de partage de la valeur et le plafond majoré à 10 000 € pour la réduction d’impôt sur les dons.
S’agissant des cotisations sociales, la liste prévoit la suppression ou la réduction de plusieurs exonérations : celles sur les heures supplémentaires, sur certaines primes (PPVA) et, surtout, la « réduction générale », qui s’éteint désormais au-delà de 1,88 Smic.
Enfin, la liste intègre la suppression des dispositifs fiscaux avantageant les transmissions patrimoniales les plus élevées.
Tableau 1 – Mesure en réduction de dépenses fiscales
ii) Augmentation des recettes : 65 Mds, soit 2,2% du PIB 2025
Côté patrimoine, les mesures incluent l’instauration d’une taxe plancher sur les très hauts patrimoines et la suppression du prélèvement forfaitaire unique sur les rendements du patrimoine (PFU). Elles prévoient aussi la restauration de la taxe d’habitation pour les 20 % de ménages les plus aisés, un renforcement de la taxe sur les transactions (TTF). Du côté des entreprises, une taxe sur les multinationales sur leur bénéfice mondial en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé en France ; pour les ménages, un plafonnement du quotient conjugal pour les couples aux revenus les plus élevés. Enfin, un effort sur la lutte contre la fraude fiscale et sociale : impôt sur le revenu, TVA et cotisations sociales. L’ensemble de ces mesures représente près de 65 milliards d’euros de recettes supplémentaires.
Tableau 2 – Mesures en recettes
iii) Baisse des Dépenses : -9,7 Mds par an soit 0,3% du PIB.
Deux mesures identifiées par des travaux récents permettent de dégager des économies substantielles pour l’État.
D’une part, le retour au ciblage de l’aide unique pour l’apprentissage tel qu’en 2018, avec une réduction des niveaux de prise en charge (NPEC), générerait une économie estimée à 6,2 milliards d’euros pour l’État central, selon l’OFCE (Policy Brief n°135, septembre 2024). D’autre part, le rapport de l’Assemblée nationale (novembre 2024) propose de diminuer la subvention publique à l’enseignement privé en contrepartie d’une hausse des frais de scolarité : passer d’un taux de subvention de 75 % à 60 % (ou 50 %) réduirait la dépense publique de 2 à 3,5 milliards d’euros pour l’État, à comparer à un coût de 8,5 Mds€ en 2022 (État) et 1,9 Mds€ (collectivités). Ensemble, ces deux mesures représentent donc une économie potentielle de 8 à 10 milliards d’euros par an, soit environ 0,3% du PIB.[11]
Tableau 3 – Mesures en réduction de dépenses directes
B. Besoins budgétaires environ 2,6% du PIB 2025
Une hausse des investissements publics, ciblée sur quatre domaines prioritaires intégrant des facteurs de long terme, a pour objectif d’enrayer la dégradation de la productivité française et de renforcer la résilience face aux tensions géopolitiques.
Ecologie : Selon les différentes estimations disponibles, la contribution attendue de la puissance publique aux investissements supplémentaires nécessaires se situe entre 25 et 40 milliards d’euros par an. Rapportées au PIB, ces dépenses publiques additionnelles représenteraient entre 0,8 % et 1,3 % du PIB français en 2025 (Mafouz, Pisani-Ferry 2023, I4CE 2025 Avant-garde, 2025). Ce montant correspond au surcroît d’investissements nécessaires dans la rénovation énergétique des bâtiments, les infrastructures de transport et d’énergie, ainsi que dans l’adaptation aux aléas climatiques. L’estimation repose sur l’écart entre une trajectoire “tendancielle” et celle compatible avec la neutralité carbone : la dépense publique est indispensable pour amorcer et soutenir ces investissements, en particulier là où la rentabilité privée est insuffisante et les externalités climatiques fortes.
Education : un montant de 15 à 20 Mds d’euros par, équivalent à 0,5 à 0,7% du PIB de 2025 est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures suivantes augmentation des bourses de l’enseignement supérieur pour les étudiants issus de classe populaire et moyenne (7,4 Mds), augmentation de l’encadrement en licence universitaire (2 Mds), ouverture de places dans les formations post-bac en tension (1,2 Mds), revaloriser les salaires des personnels de l’éducation nationale (5 à 9 Mds).[12]
Santé : Le Ségur de la santé (2021) avait prévu une enveloppe de 7,5 milliards d’euros pour financer des projets immobiliers hospitaliers (6,5 Mds via la CADES d’ici 2028, 1 Md via le plan de relance européen). Mais, selon l’IGAS (2025), les appels à projets régionaux ont recensé 796 opérations représentant 31,3 Mds€ d’investissements (valeur 2024). Il en résulte un écart de financement d’environ 23,8 Mds€ entre les besoins exprimés et les crédits du Ségur. Pour respecter la programmation et couvrir l’ensemble des projets, il faudrait porter le rythme d’investissement hospitalier à 6–8 Mds€ par an (toutes sources confondues), contre seulement 1,5–2 Mds€ par an actuellement couverts par le Ségur (soit entre 0,1 et 0,3% du PIB de 2025).
Justice : malgré la LOPJ 2023-2027 (+10 000 ETP), la mission Justice sous-exécute encore son plafond de 1 572 ETPT en 2024, signe de tensions de recrutement persistantes (surtout pénitentiaire) et de besoins RH non couverts. En 2024, l’investissement recule (Titre V : AE −17,4 %, CP −12,2 %) et subit gels/annulations, dégradant la trajectoire immobilière (notamment le plan 15 000 places).
Dépenses militaires : Dans le domaine militaire, la Loi de programmation militaire 2024- 2030 prévoit une hausse progressive du budget de défense à 67,4 Mds€ en 2030 (hors pensions), contre 50,5 Mds€ en 2025 (Ministère des Armées, Chiffres clés 2025). Cependant, plusieurs analyses soulignent que cet effort resterait insuffisant face aux exigences de réarmement dans un contexte géopolitique dégradé. France Stratégie (2024) indique que le passage à un effort de défense de l’ordre de 3 % du PIB supposerait de dépasser nettement la trajectoire actuelle, impliquant un besoin additionnel d’environ +20 Mds€ par an d’ici la fin de la décennie (soit 0,7% du PIB de 2025). Cet ordre de grandeur est cohérent avec les évaluations parlementaires sur la soutenabilité de la LPM et les discussions européennes autour d’un renforcement capacitaire commun.
Tableau 4 – Besoins en dépenses
C. Réduction du déficit
En 2025, la France enregistre un déficit primaire de 3,4 % du PIB. Dans ce qui suit, je retiens un horizon d’ajustement de six ans, qui constitue un compromis entre la faisabilité économique et politique et la crédibilité financière. Cet horizon détermine un arbitrage délicat : trop rapide, l’effort budgétaire aurait certes le mérite de rassurer les créanciers, mais il pèserait excessivement sur l’activité économique et se heurterait à la difficulté pratique de mettre en œuvre en peu de temps l’ensemble des mesures identifiées ; trop lent, en revanche, il ne convaincrait pas les investisseurs et exposerait l’État au risque d’une hausse soutenue de la charge d’intérêts.
Par ailleurs, la note raisonne sur le déficit primaire total, et non sur le déficit primaire structurel comme l’exigent les règles budgétaires européennes. Le choix de la Commission de privilégier le solde structurel s’explique par l’idée que le gouvernement ne maîtrise que les déterminants structurels des finances publiques, tandis que le solde conjoncturel reflète des évolutions liées au cycle économique sur lesquelles il a peu de prise. Or, cette note explore l’intuition que les mesures budgétaires n’ont pas toutes le même effet multiplicateur, et que leur impact se traduit à la fois sur le solde structurel et sur le solde conjoncturel. Il est donc nécessaire de considérer la dynamique du solde primaire dans son ensemble, puisque c’est lui, in fine, qui conditionne la soutenabilité de la trajectoire budgétaire et la crédibilité vis-à-vis des marchés financiers.
2. Traduction en chocs macroéconomiques
Les mesures retenues ci-dessus donnent un ordre de grandeur des capacités fiscales et budgétaires qu’on pourrait mobiliser pour ajuster le solde primaire et réaliser des investissements publics. Le Tableau ci-dessous indique le total des moyens mobilisés ainsi que leur répartition par type d’impôt.
Tableau 5 – Synthèse des mesures
A. Répartition annuelle
Le Tableau 6 présente la répartition retenue, qui concentre davantage de moyens sur la première année, ce qui procède d’un choix assumé et délibérément « politique ». Les mesures sur l’impôt sur le revenu et la TVA ne sont pas mobilisées à ce stade, tandis que la contribution de l’impôt sur les sociétés est fixée à un niveau inférieur à la moyenne annuelle prévue. À l’inverse, une part substantielle de l’effort repose sur la fiscalité du patrimoine. Enfin, la trajectoire prévoit un effort de réduction du déficit primaire plus marqué au cours de cette première année que dans les années suivantes.
Tableau 6 – Répartition des mesures en Mds d’euros constants par an
Lecture : en année 1, les recettes sur le patrimoine et de l’IS augmentent respectivement de 20 et 8 Mds de façon permanente ; ces recettes financent une augmentation de la dépense publique permanente de 20 Mds d’Euros et une réduction du déficit primaire de 8 Mds Euros.
B. Les multiplicateurs
Le modèle Mésange de l’économie française, développé par l’INSEE et la DG Trésor, estime des valeurs de multiplicateurs par type de choc économique. Chaque mesure détaillée ci-dessus est associée à un multiplicateur budgétaire, qui mesure l’impact sur le PIB pendant 6 ans d’une variation d’1 point de PIB de cette mesure en année 1.
Le multiplicateur des dépenses publiques dans Mésange correspond à celui d’une dépense publique générique, c’est-à-dire à un choc composite réparti entre investissement public, rémunérations des agents publics, prestations sociales (en espèces et en nature) et consommations intermédiaires. Un second multiplicateur, également estimé dans Mésange, concerne spécifiquement un choc d’investissement public, constitué majoritairement d’investissements dans le bâtiment et les travaux publics, partiellement dans les services exposés et dans les biens manufacturiers. Ce multiplicateur présente une valeur sensiblement plus élevée. Compte tenu de la composition des mesures budgétaires envisagées — la transition incluant une part de bâtiment, l’éducation des rémunérations publiques, et le militaire des achats de biens manufacturiers — la valeur pertinente se situe vraisemblablement entre les deux. Je retiens toutefois une hypothèse conservatrice, en utilisant le multiplicateur le plus bas. Voici une version plus fluide et précise :
Le multiplicateur retenu pour les cotisations sociales est celui des cotisations employeurs, les plus directement affectées par les mesures envisagées. Pour l’IR/CSG, nous utilisons le multiplicateur de l’impôt sur le revenu, très proche de celui de la CSG. Enfin, le multiplicateur de TVA est directement celui du modèle Mésange.
Enfin, les multiplicateurs de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la taxation du patrimoine ne sont pas estimés dans Mésange. Le premier provient d’une estimation de l’OFCE[13], tandis que la faible valeur retenue pour le second (0,2) s’explique non seulement par une faible propension marginale à consommer (PMC), mais surtout par un effet très limité sur l’investissement, tel que documenté dans les travaux d’évaluation récents (Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital, 2023).
Cette valeur se justifie également par le fait que l’allocation de portefeuille comporte empiriquement une part réduite d’actifs domestiques, en raison de la diversification internationale des placements. Autrement dit, la fraction des revenus du capital initialement réinvestie dans des actifs français — et dont la taxation pourrait priver l’économie nationale d’une source de financement privé — demeure largement minoritaire dans le portefeuille moyen. Un exercice de sensibilité est présenté en annexe, avec un multiplicateur alternatif de 0,5.
Les années 4 et 6, non estimées par le modèle Mésange, sont obtenues par interpolation linéaire : l’année 4 est la moyenne des années 3 et 5 ; l’année 6 prolonge l’écart observé entre les années 4 et 5.
Tableau 7 – Multiplicateurs associés aux mesures
Lecture : En année 1, l’impulsion de dépenses publiques a un effet multiplicateur égal à 0,78. Cela signifie qu’un euro public investi entraîne une augmentation de l’activité agrégée de 78 centimes par rapport au scénario central (sans choc). L’effet persiste et par exemple en année 6 le choc initial entraîne toujours une augmentation de l’activité agrégée de 0,78 centimes par rapport au scénario central de l’année 6.
3. Résultats sur le solde primaire et la dynamique de la dette publique
A. Impact sur le PIB
On commence par simuler l’effet sur le PIB des mesures détaillées plus haut, qui reviennent à un choc de dépense publique financé par de nouvelles recettes fiscales. Deux blocs sont considérés : (i) un choc positif de dépense publique équivalent à 2,6 % du PIB ; (ii) un ensemble de mesures d’effort fiscal et budgétaire constituant un choc négatif équivalent à 4 % du PIB ; l’écart est affecté à l’ajustement du solde primaire structurel (1,4%).
Chaque année, la variation du PIB par rapport au scénario central est :
Où :
- sₜʲ = taille de la mesure budgétaire ou fiscale « j » en année « t » (en % du PIB)
- mₜʲ = multiplicateur associé à la mesure « j » en année « t » (impact sur le PIB d’un choc de 1 point de PIB)
Conformément à l’approximation linéaire de Mésange (valable pour des chocs d’ampleur limitée), le scénario agrégé est obtenu comme combinaison linéaire des réponses : pour chaque année, on calcule une moyenne pondérée des multiplicateurs par instrument, les poids étant les parts de chaque mesure dans le PIB. Comme on l’a noté plus haut, les effets multiplicateurs estimés dans Mésange sont persistants (ici 6 ans). L’effet des chocs est donc cumulatif : par exemple, le PIB en année 2 varie du fait des effets multiplicateur des chocs des année 1 et 2.
Les multiplicateurs par instrument intègrent les réactions comportementales propres à chaque choc pris isolément ; en revanche, l’agrégation suppose l’absence d’effets d’interaction entre chocs.
Cette lecture relève d’équilibres partiels / effets de premier ordre. L’hypothèse de linéarité est autorisée par Mésange tant que l’ampleur des chocs reste limitée à l’échelle annuelle. Cela dit, le cumul pluriannuel est non négligeable : une extension utile consisterait à introduire des interactions entre chocs (rétroactions croisées ménages-entreprises-prix-taux).
B. Impact sur le solde primaire et la dette publique
Chaque année, on additionne la variation des deux composantes du solde primaire pour obtenir son évolution annuelle :
Où :
- Composante structurelle (bₜˢ): effort direct, égal au montant consacré à la réduction du déficit en année t, exprimées en points de PIB.
- Composante conjoncturelle (bₜᶜ): effet indirect lié à la variation du PIB par rapport au scénario central, avec une élasticité de 0,57 (chaque point de PIB modifie le solde primaire de 0,57 point)[14].
Le solde primaire de l’année n est donné par :
La dynamique de la dette est alors simplement :
Où est le stock de dette/PIB en année t (117,8% en année 1), r le taux obligataire implicite, g le taux de croissance nominal et le solde primaire (-3,1% en année 1). Les valeurs de r et g sont issues des projections de la Commission Européenne (DSA)[15] ; la valeur de g est néanmoins ajustée de la variation annuelle d’activité telle que :
L’application de la répartition annuelle des mesures fournit les résultats suivants :
Tableau 8 – Résultats de la simulation (en % du PIB)
Lecture : en année 1, les mesures génèrent + 0,34% de PIB supplémentaire par rapport au scénario central, ce qui améliore le solde cyclique de 0,19 points de PIB. La combinaison de l’amélioration structurelle (0,27% PIB) et cyclique entraîne une amélioration du solde primaire de 0.46% du PIB. À horizon 6 ans, l’amélioration du solde primaire s’établit à 3.67 % du PIB par rapport au scénario de référence, ce qui ramène le solde primaire à un excédent de 0,3% du PIB et une dette publique égale à 117,84% du PIB.
Les résultats de la simulation mettent en évidence une amélioration progressive du solde primaire, entre 0,5 et 0,6% de PIB par an. Cette amélioration résulte de deux composantes distinctes : d’une part, une amélioration du solde structurel entre 0,2 et 0,3% du PIB par an, et d’autre part, une amélioration du solde conjoncturel entre 0,2 et 0,4% de PIB par an.
L’effet négatif des nouvelles recettes levées est plus que compensé par l’effet multiplicateur positif lié à l’accroissement des dépenses publiques. Au total, l’ajustement budgétaire simulé permet non seulement de neutraliser le déficit primaire actuel, mais conduit même à un solde primaire légèrement positif : pour rappel, le solde primaire au moment du choc est égal à -3,1% et il atteint un solde positif de 0,4% du PIB en année 6, toutes choses égales par ailleurs.[16]
Figure 1 – Trajectoire Dette/PIB (période d’ajustement 2025-2031)
Le résultat est encourageant : l’amélioration du solde primaire et le léger surcroit d’activité permettent d’enrayer la hausse de la dette pendant cette période comme le montre la Figure 1. En effet, le ratio de dette résulte de l’accumulation des soldes primaires et de l’écart entre le taux de croissance et le taux d’emprunt obligataire. La légère accélération de croissance rend plus favorable cet écart et ralentit mécaniquement la progression du stock. La dette continue à augmenter jusqu’en année 4 et commence à reculer à partir de l’année 5 du fait d’un solde primaire excédentaire. Elle atteint alors 117,3% du PIB en année 6. Puis, les effets des chocs conjoncturels s’estompent progressivement au fur et à mesure que les multiplicateurs décroissent. Sans ajustement structurel supplémentaire, le ratio de dette publique recommence à croître progressivement après l’année 6.
Cet exercice de simulation met en lumière une alternative crédible à la stratégie budgétaire qui demeure aujourd’hui quasi la seule envisagée dans les notes sur le sujet et qui concentre l’essentiel de l’effort structurel en début de période (voir par exemple CAE, 2025). Il montre qu’il est possible d’adopter une trajectoire plus équilibrée, en réalisant des ajustements mesurés au départ pour préserver des marges de manœuvre budgétaires destinées aux investissements de long terme, sans pour autant compromettre la soutenabilité des finances publiques. Une telle approche relâche la pression immédiate sur le budget et permet d’engager dès à présent les investissements indispensables dans la transition écologique, l’éducation ou la santé, plutôt que de les différer à la fin du cycle d’ajustement. Cette stratégie présente un double avantage : elle renforce d’abord l’adhésion politique, en évitant une dégradation des conditions de vie des citoyennes et des citoyens, et elle soutient ensuite la croissance potentielle en misant sur les facteurs qui améliorent nos capacités productives. En orientant l’investissement public vers l’éducation et vers les transformations nécessaires au nouveau contexte environnemental et géopolitique, elle accroît la productivité, rend l’ajustement futur moins coûteux — car les recettes progressent sans alourdir la pression fiscale — et réduit la vulnérabilité face aux chocs économiques et climatiques, dont l’impact est d’autant plus limité que la transition est déjà amorcée.
Conclusion
La contribution de cette note est avant tout méthodologique : elle montre qu’apprécier une trajectoire budgétaire suppose de tenir compte de multiplicateurs différenciés selon la nature des mesures (dépenses, impôts, cotisations, patrimoine), plutôt que d’un multiplicateur unique. En agrégeant des mesures ciblées — faible multiplicateur côté recettes, impulsion sélective côté dépenses — et en appliquant cette combinaison dans un cadre Mésange, la trajectoire simulée ramène le solde primaire en excédent dès la sixième année, après une phase où la dette publique continue de croître jusqu’à la quatrième année avant de reculer, pour atteindre environ 117,4 % du PIB. Par la suite, les effets conjoncturels s’estompent à mesure que les multiplicateurs décroissent, et, sans ajustement structurel supplémentaire, le ratio de dette recommence à croître progressivement.
Au-delà de cet exercice comptable, la simulation illustre qu’une autre stratégie budgétaire est possible : plutôt que de concentrer tout l’effort structurel en début de période — comme le font la plupart des scénarios—, des ajustements mesurés permettent de préserver des marges de manœuvre pour l’investissement public dans la transition, l’éducation ou la santé, sans dégrader la soutenabilité. Cette approche relâche la contrainte budgétaire immédiate, favorise l’adhésion politique et soutient la croissance potentielle en améliorant les capacités productives de long terme. En préparant dès maintenant les transformations environnementales et géopolitiques nécessaires, elle réduit aussi la vulnérabilité future de l’économie face aux chocs.
Les résultats chiffrés restent illustratifs et dépendants des hypothèses retenues (valeurs de multiplicateurs, élasticité budgétaire au cycle, différentiel i-g), mais ils constituent un cadre utile pour comparer des programmes d’ajustement et éclairer les arbitrages entre soutenabilité, activité et investissement public.
Anne-Laure Delatte
Image : Rick Guidice, A colony’s windows, 1970s.
À lire aussi :
- Un budget vert foncé ?
- La France sur une nouvelle trajectoire ?
- Climat contre budget : quelle trajectoire est soutenable ?
Notes
[1] Conseil d’analyse économique, « Comment stabiliser la dette publique ? » (Focus n° 124, octobre 2025) ; Conseil d’analyse économique, « Quelle trajectoire pour Finances publiques françaises ? » (Note n°82 juillet 2024) ; OFCE, « Quelle trajectoire pour Finances publiques françaises ? » Document de travail n°13, 2025. Cepremap, « Réduction de la dette publique française : quelles implications pour les choix budgétaires de l’État ? » (Note de l’Observatoire de Macroéconomie, n°2024-02, 2024). « Consolidation budgétaire et risque de hausse de la dette publique » (Note de l’Observatoire de Macroéconomie, n°2024-3, Novembre 2024)
[2] La méthode retenue ici ne considère que l’effet multiplicateur sur la croissance de court terme mais on pourrait en outre intégrer les effets sur la croissance potentielle, documentés dans la littérature.
[3] Selon l’étude de l’IPP incluse dans le rapport France Stratégie CNEPI, les effets positifs du CIR concernent surtout les micros et petites entreprises, tandis qu’aucun impact significatif n’est observé pour les entreprises de taille plus importante, y compris les ETI. Or, selon le rapport, en 2021 les PME bénéficient de moins de la moitié de la créance totale qui en 2024 celle-ci est estimée à 7,8 Mds Euros.
[4] Selon l’IPP, les consommateurs n’ont quasi pas profité de la mesure ; les employés et les fournisseurs ont capté respectivement 18,6 % et 12,1 % des gains, et les propriétaires environ 56 %. L’analyse des relèvements ultérieurs de TVA (janv. 2012 : 5,5 %→7 % ; janv. 2014 : 7 %→10 %) montre en outre que les prix ont augmenté 4 à 5 fois plus qu’ils n’avaient baissé, ce qui suggère que les baisses temporaires de TVA bénéficient surtout aux entreprises et, une fois retirées, peuvent pousser les prix d’équilibre à la hausse (Youssef Benzarti, Dorian Carlon (2018) « Qui a bénéficié de la baisse de la TVA dans la restauration en 2009 ? », Note de l’IPP n° 32
[5] Les mesures incluent la fin des tarifs réduits sur le gazole agricole, routier, non routier et utilisé par les taxis (Tableau 2, p.6, IGF, 2023).
[6] Les coûts d’exonération des compléments de salaire ont augmenté de 93% entre 2011 et 2022. Parmi ces avantage fiscaux et sociaux, seule la prime de partage de la valeur (PPV) est globalement proportionnelle à la répartition des revenus. L’intéressement, les PEE et les PERCO se concentrent sur les salaires supérieurs à 1,5 SMIC, et pour les PERCO, à 3 SMIC (p. 121).
[7] L’abattement de 10 % sur les pensions, instauré en 1977 pour compenser le décalage d’un an du paiement de l’impôt qui pénalisait les nouveaux retraités, bénéficie surtout aux foyers aisés et apparaît désormais obsolète avec le prélèvement contemporain. Le CPO propose de le remplacer par une déduction forfaitaire et plafonnée, recentrée sur les retraités modestes et intermédiaires, générant un gain budgétaire d’au moins 1,3 Md€ (Tableau 26, P. 65); le passage au taux normal de 9,2% aux 10% des retraités les plus riches génère un gain budgétaire de 0,5 Mds (CPO, 2024, Conforter l’égalité des citoyens devant l’imposition des revenus, pp. 62-68).
[8] Les recettes sont estimées selon le scénario « first mover », dans lequel la France serait le premier pays à appliquer un taux minimum effectif global. Dans ce cadre, les multinationales opérant en France — qu’elles soient françaises ou étrangères — sont imposées sur leur déficit fiscal, défini comme l’écart entre l’impôt effectivement acquitté dans le monde et celui qu’elles auraient dû verser si leurs bénéfices avaient été imposés à 25 %. La France capte ensuite la fraction de ce déficit correspondant à sa part dans le chiffre d’affaires mondial de chaque multinationale.
[9] Le quotient conjugal procure un avantage fiscal croissant avec le revenu, fortement concentré dans le dernier décile, qui concentre une large part du gain total. Selon les estimations de la DG Trésor, un plafonnement de 10 000 € toucherait environ 200 000 foyers, soit 7 % des couples de ce décile. Et selon le CPO il contribuerait à augmenter le taux d’emploi des femmes dans les couples à haut revenu.
[10] D’après la Cour des Comptes, le gain de la suppression de la taxe d’habitation par unité de consommation est fortement inégal : il augmente à peu près linéairement jusqu’au 9e décile, puis bondit pour les 10 % les plus aisés. La suppression entre 2021 et 2023 pour les 20 % de ménages aux revenus les plus élevés (a donc eu un effet nettement anti-redistributif.
[11] Aucune mesure nouvelle n’est retenue dans le champ de la santé, la seule option n’impliquant pas une hausse de la participation individuelle — la réduction du prix des médicaments, obtenue par la négociation avec les laboratoires ou par un recours accru aux génériques — étant déjà intégrée au PLFSS 2025, pour un montant estimé à 1,2 milliard d’euros par an.
[12] Le chiffrage est issu d’une note produite par un groupe de spécialistes de l’Education diffusé aux différents partis du NFP. La Note CAE N°68 est la source principale du chiffrage des mesures ci-dessus. (« Enseignement supérieur : pour un investissement plus juste et plus efficace », G. Fack et E. Huillery, Déc. 2021).
[13] OFCE, 2017, « Evaluation du programme présidentiel pour le quinquennat 2017-2022, Policy Brief 25, Sciences Po Paris.
[14] À court terme, une augmentation du PIB de 1 % augmente les recettes fiscales d’environ 1 % (élasticité unitaire) et a peu d’effet sur les dépenses publiques en niveau. Le ratio de déficit sur PIB baisse donc quasiment au même niveau que le rapport des dépenses sur le PIB, soit d’environ 0,57 point.
[15] Le taux obligataire implicite r dans les projections DSA tient compte de la structure de maturité de la dette française.
[16] Le solde primaire serait égal à -0.3% du PIB avec une valeur double sur multiplicateur sur le patrimoine (0,4 au lieu de 0,2).