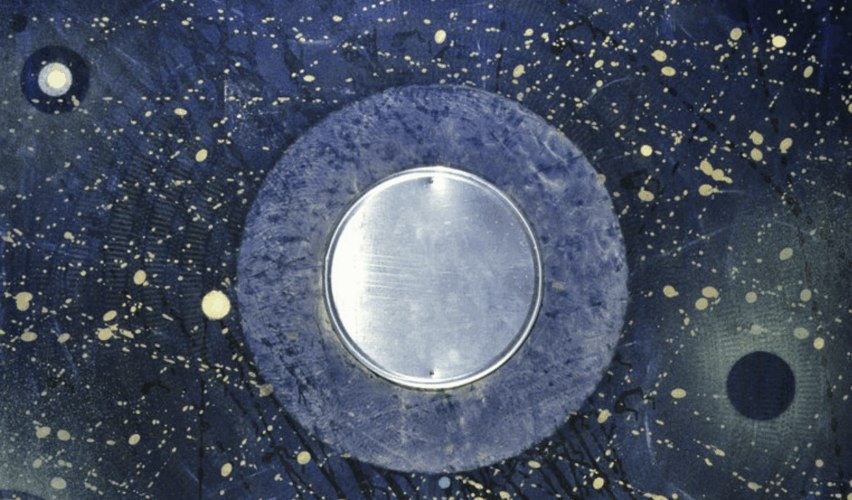La dette française est détenue à 55 % par des non-résidents. Il s’agit du taux le plus élevé des pays du G7. Quelles sont les implications ? Dans cette note, nous commençons par retracer le contexte historique qui a mené à une proportion aussi élevée. Nous montrons qu’elle a été le résultat d’évolutions majeures et délibérées de nos modes de gestion de la dette publique, qui ne sont pas immuables. Nous explorons ensuite la littérature économique : si l’accroissement de la part de ces investisseurs est associée à des taux d’emprunt plus bas, ceux-ci rendent la France particulièrement vulnérable aux chocs financiers et géopolitiques. Enfin, dans une dernière partie plus normative, nous mettons en avant certains exemples historiques et plus récents de programmes pour davantage attirer les investisseurs de détail, ainsi que d’émission de bons associés à des dépenses existentielles. L’engagement de ces créditeurs pourrait participer à la stabilisation du crédit de l’État, mais également à redonner du sens à la dette publique alors que celle-ci fait l’objet de discours catastrophistes.
Dans un contexte où la dette publique est sur toutes les lèvres, il est plus que jamais important de se pencher sur les facteurs de sa soutenabilité. Dans ce billet, nous abordons la question spécifique des détenteurs de la dette publique française. Comme le rappelait François Ecalle (spécialiste des finances publiques et membre de notre Conseil scientifique) dans une note, la dette française est aujourd’hui détenue à 55 % par des non-résidents alors que ce taux n’était que de 30% en moyenne dans les pays du G7 en 2024. Selon les données du FMI, ce taux est même le plus élevé des pays du G7.
A l’inverse, des pays comme le Japon, enregistrent une part d’investisseurs non-résidents très faible, seulement 10% du total dans le cas de ce dernier. Or le Japon est toujours noté catégorie A par les trois principales agences de notation et emprunte à 1,5% à dix ans (contre 3,5% pour la France) malgré un ratio d’endettement supérieur à 200% du PIB. La faible part des non-résidents est explicitement mise en avant pour justifier cette notation. Ainsi, selon Moody’s ou Fitch, la possibilité d’un choc financier majeur au Japon, similaire à celui déclenché par le plan budgétaire de l’ancienne Première ministre britannique Liz Truss, « est beaucoup plus faible que dans d’autres marchés développés », en raison de la stabilité des investisseurs nationaux.
Un niveau de détention par des non-résidents proche du pic historique
Cette large part de détenteurs étrangers n’est donc pas la norme dans les pays du G7, mais elle ne l’est pas non plus au regard de l’histoire financière française (Graphique 1). Elle n’a jamais été aussi élevée depuis les années 2000 et elle est largement supérieure à la moyenne historique (26% depuis le début du XXe siècle). Ces évolutions ne sont pas anodines, plusieurs périodes peuvent être distinguées, qui correspondent à des modes de gestion très différents de la dette publique, mais également à des conceptions diverses du rôle de l’endettement et de l’État.
Graphique 1 – Détention par les non-résidents des titres de la dette (en % de la dette négociable)
Après la Seconde Guerre mondial, la part des non-résidents était remontée à 30% en raison du soutien extérieur à la Reconstruction[1], mais on assista ensuite jusqu’aux années 1980 à une forte diminution de ce taux dans le contexte de l’institutionnalisation de la doctrine du circuit. Il s’agit d’une diversification des modes de financement public, une grande partie du financement devenant hors marché[2], et reposant sur l’épargne des Français. En effet, dans un contexte de reconstruction et de planification menant à une transformation profonde de l’économie française, les modes de financement public furent entièrement repensés. Comment comprendre cette volonté de se reposer majoritairement sur l’épargne nationale ? Il faut tout d’abord replacer le circuit dans son contexte historique : celui de la défiance face aux évolutions internationales, tension déjà présente pendant l’entre-deux-guerres. En effet, comme le montre Nicolas Delalande (2016), le contexte géopolitique expliquait la défiance vis-à-vis des créanciers extérieurs et protéger le crédit de l’État était devenu un véritable acte de « défense nationale », qui s’expliquait par « une grille de lecture belliciste, issue de la Première Guerre mondiale » informant « l’interprétation politique des phénomènes économiques au début des années 1920 : inquiétude face à la diffusion de fausses nouvelles, condamnation du « défaitisme financier », peur des faussaires et des escrocs en tout genre. ».
Après la Seconde Guerre mondiale, cette méfiance vis-à-vis des créditeurs étrangers fut encore exacerbée, ce qui explique que la dette publique devienne essentiellement intérieure ; la dette extérieure fut présentée à l’époque comme une « dette instable » par la Statistique Générale de France (Leonard 2022). A l’inverse, comme l’écrit le grand spécialiste de finances publiques d’après-guerre Henry Laufenburger dans son manuel (1948) : une dette publique intérieure « ne grève jamais la fortune nationale ». Sa crainte est la suivante : après la Seconde Guerre mondiale, les pays ont des dettes record et « seule l’exigibilité d’une dette extérieure peut motiver des réalisations de certaines fractions du patrimoine national, soit par la liquidation du domaine de l’État, soit par la réquisition d’avoirs particuliers. ». La dette intérieure, elle, « se ramène à un simple rapport de créances et de dettes entre les membres de la collectivité. » (ibid.).
Ainsi, l’objectif des gestionnaires de la dette de cette époque fut de dépolitiser la dette, de protéger le crédit de l’État de l’instabilité géopolitique, et de la gérer de la manière la plus administrative possible. Les inquiétudes exprimées dans le débat public se concentraient surtout sur certaines composantes comme les avances de la Banque de France, jugées inflationnistes, mais pas sur la dette dans son ensemble, par ailleurs difficile à comptabiliser.
Mais cette tendance se renversa à partir des années 1980, et la part de non-résidents ne cessa de croître jusqu’à atteindre un pic à 64% en 2009. Pour comprendre ce revirement, il faut remonter à l’après-guerre ; c’est le haut fonctionnaire et économiste français Jacques Rueff qui mena une véritable campagne pour pousser à l’introduction d’un nouvel outil d’endettement : l’adjudication de bons du Trésor, c’est-à-dire la vente aux enchères sur les marchés internationaux. Il s’agit de la technique de financement dominante actuellement. Son intention n’était alors pas d’abaisser le coût d’endettement de la France, l’argument principal mis en avant aujourd’hui pour attirer les investisseurs étrangers (voir deuxième partie), mais bien de limiter l’endettement public pour que celui-ci ne serve qu’au strict nécessaire. Pour mieux comprendre cette nouvelle conception, nous pouvons même remonter à l’entre-deux-guerres ; Pierre Quesnay[3], l’un des piliers de la Banque de France, revint enthousiaste d’un voyage à Londres en défendant cette pratique déjà mise en place Outre-Manche. Dans son discours, ce fut la première notion de discipline de marché qui naquit. Selon lui, c’était le libre jeu de l’offre et de la demande sur un marché liquide qui pouvait permettre de définir « la (vraie) valeur » de l’argent. Si ces inflexions doctrinales émergèrent donc pendant la première moitié du XXe siècle, Benjamin Lemoine a bien montré dans son ouvrage L’ordre de la dette (2016), que cette internationalisation de la dette fut ensuite le résultat d’une politique active, construite et organisée par des hommes politiques, des hauts fonctionnaires et des banquiers. Et paradoxalement, à rebours du souhait initial de Jacques Rueff, ce fut ce développement des marchés et cette internationalisation du financement de la dette qui permit la croissance de celle-ci.
Mais alors comment expliquer la dernière évolution visible sur le Graphique 1 : une baisse de la part de détention des non-résidents depuis 2010 ? Cette tendance coïncide avec la hausse de la part de la Banque de France, qui a fortement augmenté sous l’effet des opérations d’assouplissement quantitatif. Par conséquent, comme le souligne François Ecalle, la remontée de ce taux de détention de 2021 à 2024 correspond surtout à l’arrêt de ces opérations et à la diminution du stock de titres détenus par la Banque de France. Mais ne faut-il pas voir dans ce soubresaut un changement plus profond ? On ne peut ignorer l’inflexion de la stratégie de gestion de la dette publique en temps de crise, qui n’a plus put se reposer en si grande partie sur les investisseurs internationaux, au risque de voir ses coûts de financement se dégrader significativement. En effet, depuis la crise de 2008, l’idée que le financement public pourrait s’appuyer entièrement sur des mécanismes de marché internationaux a été bien remise en question avec la mise en place de politiques monétaires non conventionnelles et le retour d’un débat sur les mécanismes de redirection d’épargne.
Une littérature économique mitigée sur le sujet
Le contexte historique mérite d’être retracé pour montrer que les modes de gestion de la dette publique ne sont pas figés, mais que nous enseigne la littérature économique sur l’impact de l’accroissement de la part des non-résidents ?
La littérature s’accorde sur le fait qu’une augmentation de la part des investisseurs étrangers est généralement associée à des taux obligataires plus faibles, mais il n’y a pas de consensus sur l’amplitude et sur la causalité. Pour Andritzky (2012), une augmentation d’un point de pourcentage de la part des non-résidents est associée à une réduction des rendements de trois à quatre points de base (pdb, centième de pourcent), un effet encore plus prononcé en zone euro (jusqu’à 6,6 pdb). Pour Arslanalp et Poghosyan (2014), la réduction est plus prononcée, entre 6 et 10 pdb[4]. Cependant, il existe une divergence dans l’interprétation du sens dominant de la causalité entre la présence d’investisseurs non-résidents et les taux. Pour Andritzky (2012) le « pull effect » (effet d’attraction car les rendements plus faibles suggèrent des fondamentaux macroéconomiques sains) dominerait généralement le « push effect » (arrivée de non-résidents qui ferait baisser les rendements) ; ceci est en particulier vrai pour la zone euro. Arslanalp et Poghosyan (2014), eux, trouvent plutôt un « push effect » à l’exception de certains pays (Grèce, Irlande, Italie, Portugal). Par ailleurs, l’effet serait asymétrique : Arslanalp et Poghosyan (2014) indiquent que l’impact négatif des investisseurs étrangers sur les taux est plus important lorsque le niveau des taux d’intérêt est élevé[5] et plus faible lorsque les taux sont bas[6]. Cela suggère que les sorties de capitaux des pays périphériques peuvent avoir un impact plus important que les entrées « valeur refuge » vers les pays aux fondamentaux les plus sains.
Si le débat reste ouvert quant à l’ampleur et au sens de la causalité entre investisseurs étrangers et baisse de taux, la littérature converge davantage lorsqu’il s’agit de leur effet sur la stabilité financière. Les investisseurs étrangers seraient à l’origine d’une hausse de la volatilité des rendements ainsi que de risques de sudden stops. Borio et McCauley (1996), par exemple, ont trouvé des effets « forts est asymétriques » lors de la turbulence du marché obligataire en Europe de 1994. Les ventes cumulées d’investisseurs non-résidents ont atteint entre 1,8 % (Italie) et 5,6 % (France) de la dette publique en quelques mois, et ont entraîné une forte augmentation de la volatilité[7]. Arslanalp et Tsuda (2012) soulignent également qu’une part croissante d’investisseurs étrangers peut augmenter le risque de refinancement et que les pays peuvent être frappés par des arrêts soudains de financement. Ce risque s’est matérialisé dans la périphérie de la zone euro, où les investisseurs étrangers ont réduit leur exposition à la dette souveraine d’environ 400 milliards de dollars américains entre mi-2010 et fin 2011. Selon eux, dans un scénario de choc de financement souverain « sévère », les investisseurs privés étrangers vendraient 30 % de leur exposition restante sur une période d’un an après leur pic. Ce chiffre se fonde sur l’expérience des pays de la zone euro en difficulté (Grèce, Irlande, Portugal). Certains pays peuvent également être touchés par un arrêt brutal des financements étrangers, simplement en raison d’une aversion accrue pour le risque à l’échelle mondiale (Calvo et Talvi, 2005).
La littérature montre également que tous les types d’investisseurs n’ont pas le même effet. Arslanalp et Tsuda (2012) concluent que les investisseurs domestiques et les banques centrales étrangères jouent un rôle stabilisateur car ils ont tendance à augmenter leurs avoirs lorsque les taux augmentent. En revanche, les banques et les investisseurs non-bancaires étrangers[8] jouent un rôle déstabilisateur, car ces investisseurs réduisent leurs avoirs dès que les rendements augmentent. Selon eux, cette dernière catégorie est la plus risquée. Arslanalp et Poghosyan (2014) constatent eux que l’impact à la baisse des investisseurs officiels étrangers sur les rendements est légèrement plus faible[9] que celui des investisseurs privés étrangers[10] pour une augmentation d’un point de pourcentage.
En revanche, les investisseurs officiels étrangers pourraient, eux, être plus sensibles à un facteur qui risque de s’avérer important à l’avenir : les tensions géopolitiques. Ce facteur est évoqué dans la note de François Ecalle « Qui détient la dette française ? Anatomie d’un risque géopolitique », et plus fondamentalement par la « Mars hypothesis » explorée par Eichengreen, Mehl et Chitu (2017). Cette hypothèse soutient que le choix des monnaies de réserve dépend de facteurs géopolitiques et de la puissance stratégique, diplomatique et militaire d’un pays, et que les puissances mondiales bénéficient d’une « prime de sécurité » ; cette dernière pourrait un jour être remise en question. Un papier de la Banque centrale européenne (Beck et al., 2025) étudie l’influence de ces tensions sur la détention de dette souveraine de la zone euro par les investisseurs étrangers en différenciant les investisseurs étrangers alignés et non-alignés. Les investisseurs étrangers détiennent près d’un quart de la dette publique de la zone euro, et ces détentions totales sont concentrées dans les pays alignés avec l’Occident. Cependant, les détentions du secteur officiel étranger[11] sont principalement détenues par des pays non alignés. Or, l’alignement géopolitique peut être une considération importante pour ce type de détenteurs. En effet, après l’invasion de l’Ukraine, les avoirs officiels des pays non-alignés ont baissé de 5% par rapport aux niveaux d’avant-guerre, ce qui s’expliquerait au moins en partie par leur non-alignement. S’il s’agit d’une baisse limitée et graduelle, ce papier n’éclaire que partiellement les risques, qui pourraient s’avérer plus importants. Il faudrait en effet étudier des chocs non linéaires et la remise en question du paradigme géopolitique actuel, comme un refroidissement brutal des relations diplomatiques avec les États-Unis[12].
Pour résumer, la littérature montre qu’une hausse de la part d’investisseurs étrangers tend à réduire les taux obligataires, mais l’ampleur et le sens de la causalité demeurent débattus. En revanche, le consensus est plus net sur le fait que ces investisseurs accroissent la volatilité et les risques de sudden stops lors des crises. Les effets diffèrent selon le type d’investisseurs : les investisseurs privés étrangers sont généralement les plus déstabilisants. Enfin, les tensions géopolitiques pourraient à l’avenir influencer davantage la détention de dette souveraine, notamment du fait de la sensibilité des investisseurs officiels étrangers non alignés.
Quelle stratégie adopter ?
Comme l’explique Cyprien Batut, on peut différencier deux types de stratégies possibles face à la versatilité des acheteurs : faire du « sur mesure », stratégie assumée par l’Agence France Trésor, en s’adaptant à une base fidèle d’acheteurs ; faire du « prêt-à-porter, c’est-à-dire viser une base plus large d’acheteurs en offrant des produits qui s’adaptent à nos propres besoins avant ceux des acheteurs. Dans un contexte de plus forte volatilité politique, géopolitique et économique, l’adoption d’une stratégie plus protectrice, permettant de réduire la volatilité des taux, pourrait se justifier. Dans notre Boite à outils du financement de la transition nous évoquons certaines pistes comme l’allongement de la maturité de la dette ou la réduction de la part de la dette indexée sur l’inflation, mais nous pourrions également envisager des pistes pour attirer davantage d’investisseurs nationaux.
Le placement de la dette publique auprès des particuliers, par exemple, s’inscrit dans une longue histoire et a déjà été mobilisé par de nombreux pays. Attirer ces investisseurs présenterait plusieurs avantages aujourd’hui. Tout d’abord, le moment est opportun puisque l’épargne des Français a atteint des sommets historiques : 18,9 % du revenu disponible brut au 2ᵉ trimestre 2025, au plus haut depuis les années 1970 et dépassant celle des Allemands. Ensuite, comme le souligne une étude de l’OCDE (2025), les investisseurs particuliers sont généralement considérés comme plus sensibles aux prix que d’autres catégories lorsqu’ils décident d’acheter, mais ils sont également plus enclins à conserver leurs titres jusqu’à leur échéance, même face à des fluctuations de prix sur le marché secondaire que certains investisseurs institutionnels. Ils sont également plus enclins à acheter lorsque les taux réels sont plus élevés, car ils achètent davantage pour le rendement que pour la liquidité. Enfin, ces investisseurs affichent un biais national plus marqué. Pour différents facteurs, dans certains pays, la demande des ménages pour les obligations d’État peut donc même avoir des effets contracyclique. Pendant la crise financière mondiale, cela fut par exemple le cas en Espagne et aux Etats-Unis : la demande augmenta entre 2008 et 2012 (ibid.).
Quant au coût de financement, les exemples sont divers. Il existe quelques opérations vertueuses, comme le montre le cas de la Belgique[13] ou du Royaume-Uni, qui a constaté qu’il était moins cher de lever des fonds via le NS&I (National Savings and Investments) que par la vente de gilts en 2024-2025. Il convient toutefois de souligner quelques limites et précautions. Ces programmes vont de pair avec des coûts élevés de mise en place et de gestion. En France, ils ont également généralement été assortis de divers avantages, se traduisant par un manque à gagner budgétaire. Comme le rappelle François Ecalle, l’emprunt Giscard d’Estaing de 1973, indexé sur le cours de l’or, a été particulièrement coûteux. En outre, ce dernier souligne que la position extérieure nette de la France vis-à-vis du reste du monde (actifs moins passifs) est négative (– 28 % du PIB), et donc que la France ne ferait que rendre l’État moins dépendant des non-résidents en rendant les entreprises, elles, plus dépendantes.
Mais il faut rappeler que le rapport à la dette possède aussi une dimension politique et symbolique forte, qui finit par avoir des conséquences économiques à la fois à travers son impact sur la confiance et sur les coûts d’emprunt. Au-delà de la question spécifique des investisseurs de détail, dans un monde de polycrises et de hausse des « besoins existentiels », selon les termes de Mario Draghi, accorder une plus grande place aux investisseurs nationaux pourrait s’avérer utile. En effet, cela permettrait ainsi de développer un engagement envers certaines grandes transformations nationales, en fléchant l’utilisation d’une partie des ressources. Pour éviter que cette solution ne génère des tensions nationalistes, elle pourrait également être portée au niveau européen. Une telle évolution participerait à changer notre rapport à la dette alors que celle-ci fait l’objet d’un discours catastrophiste ; un discours qui omet que son usage peut se justifier dans le cadre du financement de grands investissements transitoires, qui ne seront pas spontanément pris en charge par le secteur privé.
À de nombreuses reprises dans l’Histoire, la mobilisation face à des défis d’ampleur nationale s’est révélée être un moteur essentiel de participation des investisseurs au financement de la dette publique. Aux États-Unis, dans les années 1860, les efforts du banquier de Philadelphie Jay Cooke pour vendre des titres du Trésor aux particuliers ont aidé Abraham Lincoln à financer la guerre civile. Plus récemment, l’Ukraine a utilisé des « obligations de guerre » (wartime bonds) dont les recettes sont principalement destinées à soutenir les efforts militaires. Ces obligations ont triplé la dette de détail de 622 millions de dollars en février 2022 à environ 1,7 milliard de dollars en octobre 2024 (et permis de lever plus largement des montants plus importants). Mais ces bons spéciaux pourraient également servir d’autres types de causes que la défense. Il existe de nombreux autres exemples de bons de ce type, comme les obligations pour soutenir l’éducation des enfants au Brésil ou encore la mobilisation après des catastrophes naturelles. Au Japon, après le séisme de 2011 de la côte Pacifique du Tōhoku, l’idée que chacun pouvait contribuer directement à la reconstruction a suscité une forte adhésion, le Japon a à la fois mis en place une taxe spéciale, perçue comme juste et largement acceptée par la population, couplée à des reconstruction bonds.
Comme le soulignait récemment Anne-Laure Kiechel : le problème est que nous prenons la question du budget et de la dette à l’envers il faut « commencer par se dire quel est notre projet de société et ensuite quel est notre projet économique en ligne avec notre projet de société » plutôt que l’inverse. Elle ajoute que : « si vous avez une cohérence, vous pouvez même avoir des pics à 150% de dette/PIB pour investir dans quelque chose de productif pour le pays. ». Comme nous l’avons évoqué récemment dans une tribune, il y a aujourd’hui trop peu de place dans le budget pour les grandes transformations, et ce type de proposition, qui donne une utilisation concrète à la dette, pourrait permettre de mobiliser en nous accordant sur un projet de société.
Clara Leonard
Illustration : Max Ernst, Les poissons noctambules, 1972.
A lire aussi :
- Nouvelles séries historiques de la dette française : une mise en perspective inédite
- Une histoire des doctrines de la dette publique française
Notes
[1] La dette extérieure, principalement faite de prêts augmenta fortement après la guerre passa d’un niveau quasi nul en 1945 à 1 182 milliards (30 % du total) en 1950. Mais le soutien extérieur aurait même été en réalité plus important : « il est dissimulé de mille manières par le jeu des reports d’annuité, les « dons » militaires américains, la manipulation des taux de change, l’appui des partenaires européens, les opérations de « ratissage », voire la dénégation : qui se souvient de l’intervention du FMI en France en 1956-1957 ? » (Baubeau & Le Bris 2019). Les crédits du plan Marshall entre 1948 et 1952 firent double usage, car ils vinrent s’insérer dans le circuit : « les apports en devises permettent d’importer des matières premières et des équipements en dollars, mais le franc étant non convertible, la vente de ces équipements et matières premières sur le marché français suscite des ressources en francs pour le Trésor, utilisées pour le financement des investissements » (ibid.). Cependant, une fois la majeure partie de la Reconstruction effectuée, la dette extérieure se mit à nouveau à décroître en proportion, pour atteindre 8 % à la fin de la période.
[2] Hors marché : peut être entendu au sens large comme tout mécanisme qui influerait sur les conditions de financement public (réglementation ou à l’intervention d’une institution publique). Au sens strict comme la redirection automatique vers les caisses du Trésor, de l’épargne déposée chez les correspondants du Trésor.
[3] Pierre Quesnay (1895-1937) : élève de Charles Rist, directeur du service des études économiques de la Banque de France (1926-1929), directeur général de la Banque des Règlements internationaux (1930-1937).
[4] Entre 2008 et 2012, les flux entrants auraient réduit les rendements à dix ans de l’Allemagne (de 40 à 65 pdb), des Etats-Unis (de 20 à 30 pdb) et du Royaume Uni (de 35 à 60 pdb). Inversement les sorties de capitaux ont augmenté les rendements en Italie (de 40 à 70 pdb) et en Espagne (de 110 à 180 pdb).
[5] jusqu’à -0.07 pour les quantiles supérieurs, soit 7 points de base par point de pourcentage d’augmentation de la part étrangère
[6] jusqu’à -0.02, soit 2 points de base
[7] Une augmentation de la volatilité annualisée des rendements quotidiens entre 2,1 et 5,3 points de pourcentage pour les pays échantillonnés (Allemagne, France et Italie) en réponse à un changement de 1 % des avoirs non-résidents
[8] Les institutions financières non bancaires (comme les fonds de pension, les compagnies d’assurance, les fonds d’investissement) et les entreprises non financières et les ménages étrangers
[9] réduction de 7 pdb
[10] réduction de 8,5 pdb
[11] Principalement les banques centrales et les fonds souverains.
[12] Eichengreen et al. (2017) avertissent que si le rôle des États-Unis en tant que garant prévisible de la sécurité de ses alliés était remis en question, la prime de sécurité dont bénéficie le dollar américain pourrait diminuer. Dans un tel scénario hypothétique, des liquidations d’actifs libellés en dollars américains d’un montant de 750 milliards de dollars (soit 5 % de la dette publique commercialisable des États-Unis) pourraient survenir, entraînant une hausse des taux d’intérêt à long terme américains pouvant atteindre 80 points de base.
[13] En 2023, le Debt Management Officer a émis un billet à ordre d’un an assorti d’un coupon de 3,30 %, attirant une souscription record de 22 milliards d’euros. Cette émission présentait plusieurs avantages, notamment des coûts de financement à court terme inférieurs à ceux d’une émission de gros équivalente et l’absence de frais de commercialisation (OCDE 2025).