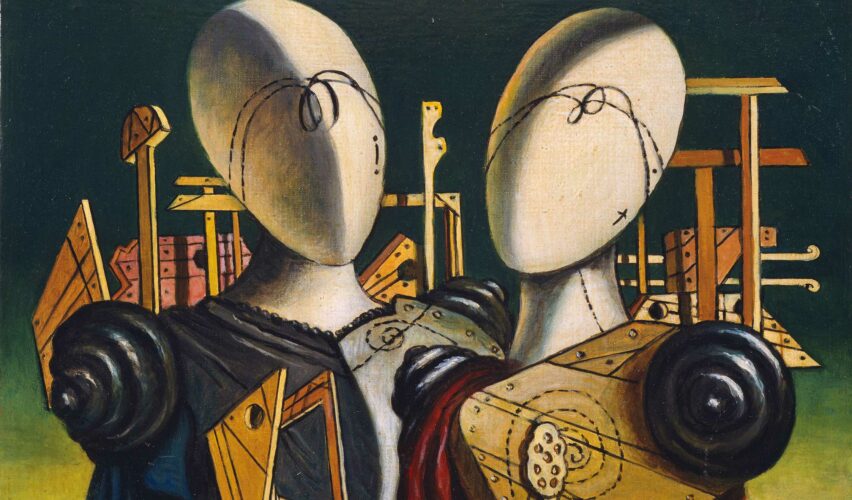La France accuse un retard massif de financements publics pour atteindre ses objectifs climatiques, estimé entre 39 et 71 milliards d’euros d’ici 2030. Faute de cadre budgétaire protecteur, ces dépenses risquent d’être sacrifiées lors des arbitrages annuels, comme on l’a vu lors du budget 2025. L’idée d’une « règle budgétaire verte » vise à sécuriser un niveau minimal d’investissements pour la transition, sur le modèle des règles budgétaires existant pour les déficits et la dette. Cette note montre que si la France dispose déjà d’une stratégie climatique (SNBC, SFEC, LPEC, SPAFTE), elle reste fragile sans ancrage budgétaire contraignant. Inspirée des expériences étrangères et appuyée sur le droit européen, une règle budgétaire verte permettrait de rééquilibrer nos institutions entre soutenabilité budgétaire et soutenabilité climatique.
En plein débat budgétaire, qui pense encore à l’environnement ? Selon I4CE, il manquera entre 39 et 71 milliards d’euros d’investissements publics d’ici 2030 pour respecter nos engagements climatiques[1]. Pourtant, le budget 2026, comme déjà celui de 2025, risque de mettre un coup d’arrêt à la progression des financements en faveur de la transition.
Pourquoi ? Parce que l’économie politique de l’inaction relègue les dépenses climatiques derrière d’autres priorités jugées plus urgentes, surtout dans un contexte politique fragmenté et de marges budgétaires réduites. Pour échapper à ce biais de court terme, les gouvernements actuels et futurs pourraient choisir de « se lier les mains » en instaurant une règle budgétaire verte garantissant un niveau de dépenses climatiques cohérent avec leurs engagements.
Certes, la loi énergie-climat de 2019 prévoyait la mise en place, à partir de 2023, d’une loi de programmation énergie-climat (LPEC) destinée à fixer les objectifs et priorités de la politique climatique nationale. Mais le gouvernement a renoncé à la faire voter en 2024, et la proposition parlementaire qui devait la remplacer n’a toujours pas abouti. Surtout, la LPEC reste une loi de programmation sectorielle : elle ne protège pas réellement les dépenses climatiques dans le budget. Une véritable règle budgétaire verte suppose donc des transformations plus profondes que celles prévues par la loi énergie-climat. C’est précisément ce que cette courte note se propose d’explorer.
Économie politique de l’inaction
L’économie politique de la dette climatique ressemble à celle de la dette publique : ceux qui tirent profit du bénéfice marginal des émissions de CO₂ ne sont pas ceux qui en supportent les coûts. Les bénéficiaires, par leur profession, la détention d’actifs polluants ou leurs intérêts financiers, ont tout intérêt à freiner la lutte contre le changement climatique, sachant que son fardeau sera assumé par d’autres. En pratique, beaucoup d’électeurs préfèrent reporter sur les générations futures l’effort de mitigation nécessaire pour effacer le poids des émissions dont ils bénéficient aujourd’hui. Les économistes décrivent cette situation comme un problème de « ressource commune »[2].
Dans les négociations budgétaires, le problème est clair : les futures victimes du changement climatique ne sont pas représentées. C’est pour répondre à cette asymétrie que nous avions publié en juin 2024 un rapport visant à mesurer la dette climatique et, à l’occasion des élections européennes, proposé la création de règles climatiques complémentaires aux règles budgétaires européennes. L’objectif était d’amener les États membres à intégrer leurs engagements climatiques dans la conduite de leurs finances publiques, afin de rééquilibrer la relation entre soutenabilité budgétaire et soutenabilité climatique dans nos institutions.
En pratique, le problème de « ressource commune » conduit trop souvent à sacrifier les investissements climatiques. Pour y remédier, une solution serait que les États s’imposent une règle budgétaire verte, les obligeant à consacrer un niveau minimal de moyens au financement de la transition environnementale. Cette logique ne serait pas sans précédent : elle s’inspire des règles budgétaires déjà en place dans de nombreux pays développés, comme aux Pays-Bas ou en Allemagne, même si celles-ci portent sur l’ensemble des dépenses publiques et visent généralement à en limiter la croissance.
Une base insuffisante : la loi de programmation sur l’énergie et le climat
Dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la France s’est dotée d’une Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC), dont la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) constitue l’un des trois piliers, aux côtés du Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) et de la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC).
Cette stratégie trouve son origine dans la loi Énergie-Climat du 8 novembre 2019, qui a fixé l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 et instauré l’obligation pour la France de disposer d’un cadre stratégique unique en matière de transition énergétique et climatique. La SFEC a ainsi vocation à regrouper et articuler les principaux documents existants, dont la SNBC, la PPE et le PNACC.
La même loi prévoyait également la création d’une loi de programmation sur l’énergie et le climat (LPEC), destinée à traduire la SFEC dans la loi tous les cinq ans. Cette loi-cadre devait fixer les grandes orientations, leur donner une base légale et encadrer l’action publique en matière d’énergie et de climat. À ce titre, elle aurait constitué l’équivalent, pour la transition écologique, d’une loi de programmation pluriannuelle des finances publiques.
En pratique, la France n’a pas adopté de LPEC depuis 2019 et le gouvernement a renoncé à en faire voter une en 2024. Il a même choisi de publier la PPE 3 (2025–2035) par décret, sans passer par une loi, ce qui revient à court-circuiter la LPEC. Mais même si celle-ci avait été adoptée, il faut rappeler que la LPEC reste, comme la loi de programmation militaire ou la loi de programmation pour la recherche, une loi de programmation sectorielle sans valeur budgétaire[3]. Ces lois fixent des orientations pluriannuelles et, parfois, une trajectoire financière, mais elles ne valent pas autorisation de dépense.
C’est précisément pour cette raison que le Haut Conseil pour le climat recommandait en 2023 de mieux opérationnaliser la SFEC, en prévoyant dès l’élaboration de la LPEC les moyens, mesures et instruments nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que les financements correspondants. Mais pour véritablement protéger les investissements climatiques, il est probable qu’un changement plus profond soit nécessaire.
Une règle budgétaire verte est-elle possible ?
Ce qui empêche aujourd’hui la France de se doter d’une véritable règle budgétaire verte, c’est la faiblesse du pilotage pluriannuel dans son droit budgétaire. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit un nouvel instrument : la loi de programmation pluriannuelle des finances publiques (LPFP). Celle-ci fixe, pour une période d’au moins trois ans, les trajectoires de finances publiques, notamment :
- le solde structurel et le solde effectif annuel des administrations publiques,
- l’effort structurel prévu pour chaque exercice,
- un objectif d’évolution des dépenses publiques exprimé en volume,
- une prévision d’évolution des dépenses d’investissement,
- ainsi que des plafonds pour les crédits du budget général de l’État, les prélèvements sur recettes et certaines taxes affectées.
Cependant, la jurisprudence du Conseil constitutionnel[4] garantit le principe d’annualité budgétaire, selon lequel les lois de finances ne valent que pour un exercice correspondant à l’année civile. Ce principe protège les droits du Parlement en lui permettant de renouveler chaque année son consentement à l’impôt et d’exercer un contrôle régulier, lisible et stable sur la dépense publique. En 2024, une proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un véritable cadre financier pluriannuel, qui aurait remplacé les LPFP actuelles, n’a pas dépassé l’examen en commission des lois au Sénat. La prééminence des lois budgétaires annuelles empêche donc, à ce jour, toute programmation pluriannuelle contraignante des dépenses climatiques, sauf à créer explicitement par voie constitutionnelle un nouveau cadre financier adapté.
Il serait toutefois possible de remonter dans la hiérarchie des normes en s’appuyant sur le niveau européen. La lutte contre le changement climatique constitue en effet un objectif explicite de la politique environnementale de l’Union, inscrit à l’article 191 du TFUE. L’UE a par ailleurs ratifié l’Accord de Paris, qui fixe comme objectif de contenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels et de poursuivre les efforts pour la limiter à 1,5°C.
Conformément à ces engagements, l’Union a adopté la Loi européenne sur le climat, entrée en vigueur en juillet 2021. Pièce maîtresse du Pacte vert, elle rend juridiquement contraignante la neutralité carbone à l’horizon 2050 et fixe un objectif intermédiaire : une réduction d’au moins 55 % des émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030, par rapport à 1990. C’est dans ce contexte que nous avions proposé, en 2024, de prendre plus au sérieux ces engagements européens et de les traduire dans la gouvernance plus concrètement dans la gouvernance européenne. La future actualisation de la SNBC-3 doit refléter aussi ces nouveaux objectifs.
En 2021, dans sa décision Commune de Grande-Synthe, le Conseil d’État a jugé que la France s’était bien engagée, au niveau international et européen, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, et que la SNBC, prévue par la loi, fixait donc une trajectoire contraignante pour l’État. Il a constaté que la France n’était pas sur la bonne trajectoire pour respecter ses propres objectifs et ses obligations européennes, et a enjoint le gouvernement de prendre « toutes mesures utiles » pour se remettre en conformité, notamment en alignant ses politiques avec la SNBC et le droit européen.
Ainsi, de la même manière que les règles budgétaires européennes ont été transposées dans le droit français, via les lois organiques de 2012 et 2021, qui ont créé puis renforcé le Haut Conseil des finances publiques, un cadre financier vert pourrait lui aussi trouver appui dans le droit européen.
A quoi pourrait-elle ressembler ?
Mais à quoi un tel cadre pourrait-il ressembler ? Comme la LPEC en son principe initial, il devrait d’abord refléter la SFEC, c’est-à-dire intégrer les orientations françaises en matière d’approvisionnement énergétique (PPE), d’adaptation (PNACC) et de décarbonation (SNBC).
Il devrait ensuite les traduire en engagements de dépenses sectoriels à court terme, sur un horizon de cinq ans à l’image de la LPFP, dans un format compatible avec les lois de finances annuelles. L’objectif serait de sécuriser ces dépenses dans le budget de l’État. L’adéquation de cette programmation pourrait être contrôlée conjointement par le Haut Conseil pour le climat et le Haut Conseil des finances publiques.
Idéalement, ce cadre intégrerait également la Stratégie pluriannuelle des financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale (SPAFTE). Depuis la LPFP 2023-2027, ce document stratégique recense les besoins d’investissement publics et privés pour atteindre les objectifs climatiques, ainsi que les moyens de financement correspondants. Articuler la programmation des financements avec celle des dépenses renforcerait encore la sécurisation des moyens consacrés à la transition.
Les frontières de cadre financier pourraient toutefois poser question. Tout d’abord, comment séparer la part publique et privée du financement de la transition ? L’étude d’I4CE citée plus haut[5] montre que la frontière peut être floue et surtout que celle-ci est politique : appartient-il à l’Etat de financer entièrement la transition, même l’achat des véhicules électriques ou bien la rénovation énergétique des particuliers ? Ensuite, ce cadre doit-il intégrer une mesure de dette climatique et fonctionner comme la base d’une caisse d’amortissementde celle-ci ?
En définitive, la France dispose déjà d’un arsenal stratégique et institutionnel solide pour organiser sa trajectoire climatique (SNBC, SFEC, LPEC, SPAFTE). Mais faute d’un véritable ancrage budgétaire contraignant, ces instruments restent fragiles face aux arbitrages politiques de court terme. L’expérience des règles budgétaires européennes montre pourtant qu’il est possible d’institutionnaliser des contraintes de moyen terme. Transposer cette logique au champ climatique, via une règle budgétaire verte adossée au droit européen et contrôlée par des instances indépendantes comme le HCC et le HCFP, permettrait de rééquilibrer le jeu entre soutenabilité budgétaire et soutenabilité climatique.
En d’autres termes, la question n’est plus de savoir si la France peut se doter d’une telle règle, mais si elle accepte de reconnaître que le climat mérite, lui aussi, un cadre de protection institutionnelle.
Cyprien Batut
Image : Giorgi de Chirico, Hector and Andromache, 1970, huile sur toile, 30 x 40 cmn Fondazione Giorgio e Isa de Chirico Collection, Rome.
À lire aussi
- Budget 2025 : le temps d’un premier bilan écologique
- Climat contre budget : quelle trajectoire est soutenable ?
Notes
[1] Hadrien Hainaut, Maxime Ledez, Maia Douillet et Solène Metayer. Financement de la transition : quelles marges de manœuvre autour du besoin de financement public ?, I4CE, Juillet 2024.
[2] Barry Eichengreen, Robert Feldman, Jeffrey Liebman, Jürgen von Hagen er Charles Wyplosz. Public Debts: Nuts, Bolts and Worries, Geneva report 13, 2011.
[3] Voir l’article 34 de la Constitution pour le périmètre des différents types de lois votés par le parlement.
[4] Conseil constitutionnel, décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001.
[5] Hadrien Hainaut, Maxime Ledez, Maia Douillet et Solène Metayer, Ibid.